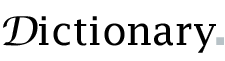Frédéric Chopin
Frédéric François Chopin [n 1] (né Fryderyk Franciszek Chopin ; [n 2] [n 3] 1er mars 1810 – 17 octobre 1849) était un compositeur polonais et pianiste virtuose de la période romantique qui écrivait principalement pour piano solo . Il a conservé une renommée mondiale en tant que musicien de premier plan de son époque, dont « le génie poétique reposait sur une technique professionnelle sans égale dans sa génération ». [5]
 Chopin, daguerréotype de Bisson , v. 1849
Chopin, daguerréotype de Bisson , v. 1849 
Chopin est né à Żelazowa Wola dans le duché de Varsovie et a grandi à Varsovie , qui en 1815 est devenue une partie de la Pologne du Congrès . Enfant prodige , il complète son éducation musicale et compose ses premières œuvres à Varsovie avant de quitter la Pologne à l’âge de 20 ans, moins d’un mois avant le déclenchement de l’ insurrection de novembre 1830 . A 21 ans, il s’installe à Paris. Par la suite – dans les 18 dernières années de sa vie – il ne donnera plus que 30 représentations publiques, préférant l’ambiance plus intimiste du salon . Il subvenait à ses besoins en vendant ses compositions et en donnant des cours de piano, pour lesquels il était très demandé. Chopin s’est lié d’amitié avec Franz Lisztet a été admiré par beaucoup de ses autres contemporains musicaux, dont Robert Schumann .
Après un engagement raté avec Maria Wodzińska de 1836 à 1837, il entretint une relation souvent troublée avec l’écrivaine française Aurore Dupin (connue sous son pseudonyme, George Sand ). Une brève et malheureuse visite à Majorque avec Sand en 1838-1839 s’avérera l’une de ses périodes de composition les plus productives. Dans ses dernières années, il fut soutenu financièrement par son admiratrice Jane Stirling , qui lui fit également visiter l’Écosse en 1848. Pendant la majeure partie de sa vie, Chopin était en mauvaise santé. Il meurt à Paris en 1849 à l’âge de 39 ans, probablement d’ une péricardite aggravée par la tuberculose .
Toutes les compositions de Chopin incluent le piano. La plupart sont pour piano solo, bien qu’il ait également écrit deux concertos pour piano , quelques pièces de chambre et quelque 19 chansons sur des paroles polonaises . Son écriture au piano était techniquement exigeante et repoussait les limites de l’instrument, ses propres interprétations se distinguant par leur nuance et leur sensibilité. Ses principales œuvres pour piano comprennent également des mazurkas , des valses , des nocturnes , des polonaises , la ballade instrumentale (que Chopin a créée comme genre instrumental), des études , des impromptus , des scherzos ., préludes et sonates , certains publiés seulement à titre posthume. Parmi les influences sur son style de composition figuraient la musique folklorique polonaise , la tradition classique de JS Bach , Mozart et Schubert , et l’atmosphère des salons parisiens dont il était fréquemment invité. Ses innovations dans le style, l’harmonie et la forme musicale , et son association de la musique avec le nationalisme , ont eu une influence tout au long et après la fin de la période romantique .
La musique de Chopin, son statut de l’une des premières célébrités de la musique, son association indirecte avec l’insurrection politique, sa vie amoureuse très médiatisée et sa mort prématurée ont fait de lui un symbole majeur de l’ère romantique. Ses œuvres restent populaires et il a fait l’objet de nombreux films et biographies de fidélité historique variable. Parmi ses nombreux mémoriaux se trouve l’ Institut Fryderyk Chopin , qui a été créé par le Parlement de Pologne pour rechercher et promouvoir sa vie et ses œuvres. Il accueille le Concours international de piano Chopin , concours prestigieux entièrement consacré à ses œuvres.
La vie
Jeunesse
Enfance 

Fryderyk Chopin est né à Żelazowa Wola , à 46 kilomètres (29 miles) à l’ouest de Varsovie, dans ce qui était alors le duché de Varsovie , un État polonais établi par Napoléon . L’acte de baptême paroissial, qui est daté du 23 avril 1810, donne son anniversaire au 22 février 1810 et cite ses prénoms sous la forme latine Fridericus Franciscus (en polonais, il était Fryderyk Franciszek ). [6] [7] [8] Cependant, le compositeur et sa famille ont utilisé la date de naissance 1 mars, [n 4] [7] qui est maintenant généralement acceptée comme la date correcte. [8]
Son père, Nicolas Chopin , était un Français lorrain qui avait émigré en Pologne en 1787 à l’âge de seize ans. [10] [11] Il s’est marié avec Justyna Krzyżanowska , un parent pauvre du Skarbeks, une des familles pour qui il a travaillé. [12] Chopin a été baptisé dans la même église où ses parents s’étaient mariés, à Brochów . Son parrain de dix-huit ans , dont il porte le nom, était Fryderyk Skarbek , un élève de Nicolas Chopin. [7] Chopin était le deuxième enfant de Nicholas et Justyna et leur seul fils; il avait une sœur aînée, Ludwika(1807–1855), et deux sœurs cadettes, Izabela (1811–1881) et Emilia (1812–1827), dont la mort à l’âge de 14 ans était probablement due à la tuberculose . [13] [14] Nicolas Chopin était dévoué à sa patrie d’adoption et insistait sur l’utilisation de la langue polonaise dans la maison. [7]

 Le père de Chopin, Nicolas Chopin , par Mieroszewski , 1829
Le père de Chopin, Nicolas Chopin , par Mieroszewski , 1829
En octobre 1810, six mois après la naissance de Chopin, la famille s’installe à Varsovie, où son père acquiert un poste de professeur de français au Lycée de Varsovie , alors logé au Palais de Saxon . Chopin vivait avec sa famille dans l’enceinte du Palais. Le père jouait de la flûte et du violon ; [15] la mère jouait du piano et donnait des leçons aux garçons dans la pension que tenaient les Chopin. [16] Chopin était de petite taille et même dans sa petite enfance, il était sujet aux maladies. [15]
Chopin a peut-être reçu des cours de piano de sa mère, mais son premier professeur de musique professionnel, de 1816 à 1821, fut le pianiste tchèque Wojciech Żywny . [17] Sa soeur aînée Ludwika a pris aussi des leçons de Żywny et a joué de temps en temps des duos avec son frère. [18] Il est rapidement devenu évident qu’il était un enfant prodige . À l’âge de sept ans, il avait commencé à donner des concerts publics et, en 1817, il composa deux polonaises , en sol mineur et en si bémol majeur . [19] Son œuvre suivante, une polonaise en la bémol majeur de 1821, dédiée à Żywny, est son plus ancien manuscrit musical. [17]
En 1817, le palais saxon fut réquisitionné par le gouverneur russe de Varsovie pour un usage militaire, et le lycée de Varsovie fut rétabli dans le palais Kazimierz (aujourd’hui le rectorat de l’université de Varsovie ). Chopin et sa famille ont déménagé dans un bâtiment, qui subsiste encore, adjacent au palais Kazimierz. Au cours de cette période, il est parfois invité au palais de Belweder en tant que compagnon de jeu du fils du souverain de la Pologne russe , le grand-duc Konstantin Pavlovich de Russie ; il joua du piano pour Konstantin Pavlovich et composa une marche pour lui. Julian Ursyn Niemcewicz , dans son églogue dramatique , ” Nasze Przebiegi» (« Nos Discours », 1818), atteste de la popularité du « petit Chopin ». [20]
Éducation 

De septembre 1823 à 1826, Chopin fréquente le Lycée de Varsovie, où il reçoit des cours d’ orgue du musicien tchèque Wilhelm Würfel au cours de sa première année. À l’automne 1826, il entreprit un cours de trois ans auprès du compositeur silésien Józef Elsner au Conservatoire de Varsovie , étudiant le solfège , la basse chiffrée et la composition . [21] [n 5] Pendant toute cette période, il continue à composer et à donner des récitals dans des concerts et des salons à Varsovie. Il a été engagé par les inventeurs du “aeolomelodicon” (une combinaison de piano et d’orgue mécanique), et sur cet instrument en mai 1825, il a exécuté sa propre improvisation et une partie d’un concerto de Moscheles . Le succès de ce concert déboucha sur une invitation à donner un récital sur un instrument similaire (l'”aeolopantaleon”) devant le tsar Alexandre Ier , en visite à Varsovie ; le tsar lui offrit une bague en diamant. Lors d’un concert ultérieur d’aeolopantaleon le 10 juin 1825, Chopin interpréta son Rondo op. 1 . Ce fut le premier de ses ouvrages à être publié commercialement et lui valut sa première mention dans la presse étrangère, lorsque le LeipzigAllgemeine Musikalische Zeitung a loué sa “richesse d’idées musicales”. [22]
De 1824 à 1828, Chopin passa ses vacances loin de Varsovie, à plusieurs endroits. [n 6] En 1824 et 1825, à Szafarnia , il est l’hôte de Dominik Dziewanowski , le père d’un camarade de classe. Ici, pour la première fois, il a rencontré la musique folklorique rurale polonaise . [24] Ses lettres à la maison de Szafarnia (auquel il a donné le titre “Le Courrier de Szafarnia”), écrites dans un polonais très moderne et vivant, ont amusé sa famille avec leur usurpation des journaux de Varsovie et ont démontré le don littéraire du jeune. [25]
En 1827, peu après la mort de la plus jeune sœur de Chopin, Emilia, la famille a déménagé du bâtiment de l’Université de Varsovie, adjacent au palais Kazimierz, à des logements juste en face de l’université , dans l’annexe sud du palais Krasiński sur Krakowskie Przedmieście . [n 7] où Chopin a vécu jusqu’à ce qu’il quitte Varsovie en 1830. [n 8] Ici, ses parents ont continué à gérer leur pension pour étudiants masculins. Quatre pensionnaires des appartements de ses parents sont devenus les intimes de Chopin : Tytus Woyciechowski , Jan Nepomucen Białobłocki , Jan Matuszyński et Julian Fontana .. Ces deux derniers feront partie de son milieu parisien. [28]
Les lettres de Chopin à Woyciechowski de la période 1829-1830 (lorsque Chopin avait environ vingt ans) contiennent des références érotiques aux rêves et aux baisers et étreintes offerts. Selon Adam Zamoyski , de telles expressions “étaient, et dans une certaine mesure sont encore, monnaie courante en polonais et n’impliquent pas plus que le” amour ” ” concluant les lettres aujourd’hui. “L’esprit de l’époque, imprégné par le mouvement romantique dans l’art et la littérature, favorisait l’expression extrême des sentiments … Bien que la possibilité ne puisse être entièrement exclue, il est peu probable que les deux aient jamais été amants.” [29] Le biographe de Chopin, Alan Walkerconsidère que, dans la mesure où de telles expressions pourraient être perçues comme étant de nature homosexuelle, elles ne dénoteraient qu’une phase passagère dans la vie de Chopin. [30] Le Musicologue Jeffrey Kallberg note que les concepts de pratique et d’identité sexuelles étaient très différents à l’époque de Chopin, de sorte que l’interprétation moderne est problématique. [31]
Probablement au début de 1829, Chopin rencontra la chanteuse Konstancja Gładkowska et développa une affection intense pour elle, bien qu’il ne soit pas clair qu’il se soit jamais adressé directement à elle à ce sujet. Dans une lettre à Woyciechowski du 3 octobre 1829, il se réfère à son « idéal, que j’ai servi fidèlement pendant six mois, sans jamais lui dire un mot de mes sentiments ; dont je rêve, qui m’a inspiré l’Adagio de mon Concerto. ” [32] Tous les biographes de Chopin, suivant l’exemple de Frederick Niecks , [33] conviennent que cet “idéal” était Gładkowska. Après ce qui devait être le concert d’adieu de Chopin à Varsovie en octobre 1830, qui comprenait le concerto, joué par le compositeur, et Gładkowska chantant un air de Gioachino Rossini, les deux ont échangé des bagues, et deux semaines plus tard, elle a écrit dans son album quelques lignes affectueuses lui disant adieu. [34] Après que Chopin ait quitté Varsovie, ils ne se sont pas rencontrés et n’ont apparemment pas correspondu. [35]
Chopin était ami avec les membres du jeune monde artistique et intellectuel de Varsovie, dont Fontana, Józef Bohdan Zaleski et Stefan Witwicki . [28] Le rapport final du Conservatoire de Chopin (juillet 1829) disait : “Chopin F., étudiant de troisième année, talent exceptionnel, génie musical.” [21] En 1829 l’artiste Ambroży Mieroszewski a exécuté un ensemble de portraits de membres de famille Chopin, en incluant le premier portrait connu du compositeur. [n 9]
Carrière

 Chopin joue pour les Radziwiłł , 1829 (peinture de Henryk Siemiradzki , 1887) Voyage et succès domestique
Chopin joue pour les Radziwiłł , 1829 (peinture de Henryk Siemiradzki , 1887) Voyage et succès domestique
En septembre 1828, Chopin, alors qu’il était encore étudiant, visita Berlin avec un ami de la famille, le zoologiste Feliks Jarocki , appréciant les opéras dirigés par Gaspare Spontini et assistant aux concerts de Carl Friedrich Zelter , Felix Mendelssohn et d’autres célébrités. Lors d’un voyage de retour à Berlin en 1829, il fut l’invité du prince Antoni Radziwiłł , gouverneur du Grand-Duché de Posen – lui-même compositeur accompli et violoncelliste en herbe. Pour le prince et sa fille pianiste Wanda, il compose son Introduction et Polonaise brillante en ut majeur pour violoncelle et piano , op. 3. [37]
De retour à Varsovie cette année-là, Chopin entend Niccolò Paganini jouer du violon et compose un ensemble de variations, Souvenir de Paganini . C’est peut-être cette expérience qui l’a encouragé à commencer à écrire ses premières Études (1829-1832), explorant les capacités de son propre instrument. [38] Après avoir terminé ses études au Conservatoire de Varsovie, il fait ses débuts à Vienne . Il a donné deux concerts de piano et a reçu de nombreuses critiques favorables – en plus de quelques commentaires (selon les propres mots de Chopin) qu’il était “trop délicat pour ceux qui sont habitués au piano-bashing des artistes locaux”. Au premier de ces concerts, il crée ses Variations sur Là ci darem la mano, Op. 2 (variations sur un duo de l’opéra Don Giovanni de Mozart ) pour piano et orchestre. [39] Il retourna à Varsovie en septembre 1829, [28] où il créa son Concerto pour piano n° 2 en fa mineur , op. 21 le 17 mars 1830. [21]
Les succès de Chopin en tant que compositeur et interprète lui ouvrent la porte de l’Europe occidentale et, le 2 novembre 1830, il part, selon les mots de Zdzisław Jachimecki , « dans le vaste monde, sans but très clairement défini, pour toujours ». [40] Avec Woyciechowski, il se dirigea de nouveau vers l’Autriche, avec l’intention de continuer en Italie. Plus tard ce mois-là, à Varsovie, le soulèvement de novembre 1830 éclata et Woyciechowski retourna en Pologne pour s’enrôler. Chopin, désormais seul à Vienne, avait la nostalgie de sa patrie et écrivit à un ami : « Je maudis le moment de mon départ ». [41]Lorsqu’en septembre 1831, lors d’un voyage de Vienne à Paris, il apprit que l’insurrection avait été écrasée, il exprima son angoisse dans les pages de son journal intime : « Oh mon Dieu !… Tu es là, et pourtant tu ne prends pas vengeance!”. [42] Jachimecki attribue à ces événements la maturation du compositeur “en un barde national inspiré qui a deviné le passé, le présent et l’avenir de sa Pologne natale”. [40]
Paris 

Lorsqu’il quitta Varsovie à la fin de 1830, Chopin avait l’intention de se rendre en Italie, mais de violents troubles en firent une destination dangereuse. Son prochain choix était Paris; des difficultés à obtenir un visa auprès des autorités russes l’ont amené à obtenir une autorisation de transit auprès des Français. Plus tard, il citera l’endossement du passeport ” Passeport en passant par Paris à Londres ” (“En transit vers Londres via Paris”), plaisantant qu’il n’était dans la ville “que de passage”. [43] Chopin arrive à Paris fin septembre 1831 ; il ne reviendrait jamais en Pologne, [44] devenant ainsi l’un des nombreux expatriés de la Grande Émigration polonaise. En France, il a utilisé les versions françaises de ses prénoms, et après avoir reçu la nationalité française en 1835, il a voyagé avec un passeport français. [n 10] Cependant, Chopin est resté proche de ses compatriotes polonais en exil en tant qu’amis et confidents et il ne s’est jamais senti pleinement à l’aise de parler français. Le biographe de Chopin, Adam Zamoyski , écrit qu’il ne s’est jamais considéré comme français, malgré les origines françaises de son père, et qu’il s’est toujours considéré comme un Polonais. [46]
À Paris, Chopin a rencontré des artistes et d’autres personnalités distinguées et a trouvé de nombreuses occasions d’exercer ses talents et d’atteindre la célébrité. Au cours de ses années parisiennes, il fera la connaissance, entre autres, d’ Hector Berlioz , de Franz Liszt , de Ferdinand Hiller , d’ Heinrich Heine , d’ Eugène Delacroix , d’ Alfred de Vigny , [47] et de Friedrich Kalkbrenner , qui l’introduit auprès de la manufacture de pianos. Camille Pleyel . [48] Ce fut le début d’une longue et étroite association entre le compositeur et les instruments de Pleyel. [49]Chopin a également fait la connaissance du poète Adam Mickiewicz , directeur de la Société littéraire polonaise, dont il a mis certains vers en chansons. [46] Il fut aussi plus d’une fois l’invité du marquis Astolphe de Custine , l’un de ses fervents admirateurs, jouant ses œuvres dans le salon de Custine. [50]
Deux amis polonais à Paris y joueront également un rôle important dans la vie de Chopin. Un condisciple du Conservatoire de Varsovie, Julian Fontana, avait d’abord tenté sans succès de s’établir en Angleterre ; Fontana allait devenir, selon les mots de l’historien de la musique Jim Samson, le « factotum général et copiste » de Chopin. [51] Albert Grzymała , qui à Paris est devenu un riche financier et une figure de la société, a souvent agi comme conseiller de Chopin et, selon les mots de Zamoyski, “a progressivement commencé à remplir le rôle de frère aîné dans [sa] vie.” [52]
Le 7 décembre 1831, Chopin reçut la première approbation majeure d’un contemporain exceptionnel lorsque Robert Schumann , révisant l’Op. 2 Variations dans l’ Allgemeine musikalische Zeitung (son premier article publié sur la musique), déclare : « Chapeau bas, messieurs ! Un génie. [53] Le 25 février 1832, Chopin donna un premier concert parisien dans les “salons de MM Pleyel” au 9 rue Cadet, qui suscita l’admiration universelle. Le critique François-Joseph Fétis écrit dans la Revue et gazette musicale : “Voilà un jeune homme qui… ne prenant aucun modèle, a trouvé, sinon un renouveau complet de la musique pour piano,… une abondance d’idées originales d’un genre qu’on ne trouve nulle part ailleurs…” [54]Après ce concert, Chopin s’est rendu compte que sa technique de clavier essentiellement intime n’était pas optimale pour les grands espaces de concert. Plus tard cette année-là, il est présenté à la riche famille de banquiers Rothschild , dont le patronage lui ouvre également les portes d’autres salons privés (réunions sociales de l’aristocratie et de l’élite artistique et littéraire). [55] Vers la fin de 1832 Chopin s’était établi parmi l’élite musicale parisienne et avait gagné le respect de ses pairs tels que Hiller, Liszt et Berlioz. Il ne dépendait plus financièrement de son père et, à l’hiver 1832, il commença à gagner un beau revenu en publiant ses œuvres et en enseignant le piano à des étudiants aisés de toute l’Europe. 2001Cela l’a libéré des contraintes des concerts publics, qu’il n’aimait pas. [55]
Chopin se produit rarement en public à Paris. Plus tard, il donne généralement un seul concert annuel à la Salle Pleyel, une salle qui peut accueillir trois cents personnes. Il a joué plus fréquemment dans les salons mais a préféré jouer dans son propre appartement parisien pour de petits groupes d’amis. Le Musicologue Arthur Hedley a observé que “En tant que pianiste, Chopin était le seul à acquérir une réputation de premier ordre sur la base d’un minimum d’apparitions publiques – un peu plus de trente au cours de sa vie.” [55] La liste des musiciens qui ont participé à certains de ses concerts indique la richesse de la vie artistique parisienne durant cette période. Les exemples incluent un concert le 23 mars 1833, dans lequel Chopin, Liszt et Hiller ont interprété (au piano) un concerto de JS Bach pour trois claviers; et, le 3 mars 1838, un concert au cours duquel Chopin, son élève Adolphe Gutmann , Charles-Valentin Alkan et le professeur d’Alkan Joseph Zimmermann interprétèrent l’arrangement d’Alkan, pour huit mains, de deux mouvements de la 7e symphonie de Beethoven . [56] Chopin a également participé à la composition de l’ Hexameron de Liszt ; il a écrit la sixième (et dernière) variation sur le thème de Bellini . La musique de Chopin a rapidement rencontré le succès auprès des éditeurs et, en 1833, il a passé un contrat avec Maurice Schlesinger , qui s’est arrangé pour qu’elle soit publiée non seulement en France mais, grâce à ses relations familiales, également en Allemagne et en Angleterre. [57][n 11]

 Maria Wodzińska , autoportrait
Maria Wodzińska , autoportrait
Au printemps 1834, Chopin assiste au Festival de musique du Bas-Rhin à Aix-la-Chapelle avec Hiller, et c’est là que Chopin rencontre Félix Mendelssohn. Après le festival, les trois se sont rendus à Düsseldorf , où Mendelssohn avait été nommé directeur musical. Ils passèrent ce que Mendelssohn décrivait comme “une journée très agréable”, jouant et discutant de musique sur son piano, et rencontrèrent Friedrich Wilhelm Schadow , directeur de l’Académie des Beaux-Arts, et certains de ses éminents élèves tels que Lessing , Bendemann , Hildebrandt et Sohn . [59] En 1835, Chopin se rendit à Carlsbad, où il passait du temps avec ses parents ; c’était la dernière fois qu’il les verrait. De retour à Paris, il rencontre de vieux amis de Varsovie, les Wodziński. Il avait fait la connaissance de leur fille Maria en Pologne cinq ans plus tôt alors qu’elle avait onze ans. Cette rencontre le pousse à rester deux semaines à Dresde, alors qu’il avait auparavant l’intention de regagner Paris via Leipzig . [60] Le portrait de la jeune fille de seize ans du compositeur a été considéré, avec celui de Delacroix, comme parmi les meilleures ressemblances de Chopin. [61] En octobre, il atteint finalement Leipzig, où il rencontre Schumann, Clara Wieck et Mendelssohn, qui organisent pour lui une représentation de son propre oratorio St. Paul, et qui le considérait comme “un musicien parfait”. [62] En juillet de 1836 Chopin a voyagé à Marienbad et Dresde pour être avec la famille Wodziński et en septembre il a proposé à Maria, dont la mère Comtesse Wodzińska a approuvé en principe. Chopin se rend ensuite à Leipzig, où il présente à Schumann sa Ballade en sol mineur . [63] À la fin de 1836, il envoie à Maria un album dans lequel sa sœur Ludwika a inscrit sept de ses chansons, et son Nocturne de 1835 en ut dièse mineur, op. 27, n° 1 . [64] Les remerciements anodins qu’il a reçus de Maria se sont avérés être la dernière lettre qu’il devait recevoir d’elle. [65]Chopin plaça les lettres qu’il avait reçues de Maria et de sa mère dans une grande enveloppe, y écrivit les mots “Mon chagrin” ( “Moja bieda” ), et jusqu’à la fin de sa vie conserva dans un tiroir de bureau ce souvenir de la seconde l’amour de sa vie. [64] [n 12]
François Liszt 
 Franz Liszt , par Kriehuber , 1838
Franz Liszt , par Kriehuber , 1838
Bien que l’on ne sache pas exactement quand Chopin rencontra Franz Liszt pour la première fois après son arrivée à Paris, le 12 décembre 1831, il mentionna dans une lettre à son ami Woyciechowski que « j’ai rencontré Rossini , Cherubini , Baillot , etc. – également Kalkbrenner. croyez à quel point j’étais curieux de Herz , Liszt, Hiller, etc.” [66] Liszt assiste aux débuts parisiens de Chopin le 26 février 1832 à la salle Pleyel , ce qui l’amène à dire : « Les applaudissements les plus vigoureux semblaient ne pas suffire à notre enthousiasme en présence de ce musicien de talent, qui révélait une nouvelle phase de sentiment poétique combinée à une innovation si heureuse dans la forme de son art.” [67]
Les deux se sont liés d’amitié et ont longtemps vécu l’un près de l’autre à Paris, Chopin au 38 rue de la Chaussée-d’Antin , et Liszt à l’Hôtel de France, rue Laffitte , à quelques rues de là. [68] Ils se produisirent ensemble à sept reprises entre 1833 et 1841. La première, le 2 avril 1833, fut lors d’un concert-bénéfice organisé par Hector Berlioz pour sa femme, l’actrice shakespearienne en faillite Harriet Smithson , au cours duquel ils jouèrent la Sonate de George Onslow en Fa mineur pour duo avec piano. Les apparitions conjointes ultérieures comprenaient un concert-bénéfice pour l’Association bienveillante des dames polonaises à Paris. Leur dernière apparition ensemble en public était pour un concert de charité dirigé pour leMonument Beethoven à Bonn, tenue à la Salle Pleyel et au Conservatoire de Paris les 25 et 26 avril 1841. [67]
Bien que les deux aient montré un grand respect et une grande admiration l’un pour l’autre, leur amitié était difficile et avait certaines qualités d’une relation amour-haine. Harold C. Schonberg croit que Chopin a montré une “teinte de jalousie et de dépit” envers la virtuosité de Liszt au piano, [68] et d’autres ont également soutenu qu’il était devenu enchanté par la théâtralité, le sens du spectacle et le succès de Liszt. [69] Liszt était le dédicataire de l’op. 10 Études , et son interprétation de celles-ci a incité le compositeur à écrire à Hiller: “Je voudrais lui voler la façon dont il joue mes études.” [70]Cependant, Chopin a exprimé son agacement en 1843 lorsque Liszt a interprété l’un de ses nocturnes avec l’ajout de nombreux embellissements complexes, au cours desquels Chopin a fait remarquer qu’il devait jouer la musique telle qu’elle était écrite ou ne pas la jouer du tout, forçant des excuses. La plupart des biographes de Chopin déclarent qu’après cela, les deux n’avaient plus grand-chose à voir l’un avec l’autre, bien que dans ses lettres datées de 1848, il l’appelait encore “mon ami Liszt”. [68] Certains commentateurs soulignent des événements dans la vie romantique des deux hommes qui ont conduit à une rupture entre eux; on prétend que Liszt avait manifesté de la jalousie à l’égard de l’obsession de sa maîtresse Marie d’Agoult pour Chopin, tandis que d’autres pensent que Chopin s’était inquiété de la relation croissante de Liszt avec George Sand .[67]
George Sand 
 Chopin à 28 ans, d’après le portrait conjoint de Delacroix de Chopin et Sand , 1838
Chopin à 28 ans, d’après le portrait conjoint de Delacroix de Chopin et Sand , 1838
En 1836, lors d’une fête organisée par Marie d’Agoult, Chopin rencontre l’auteur français George Sand (née [Amantine] Aurore [Lucile] Dupin). Petite (moins de cinq pieds ou 152 cm), brune, aux grands yeux et fumeuse de cigares, [71] elle a d’abord repoussé Chopin, qui a fait remarquer: “Quelle personne peu attrayante est la Sand . Est-elle vraiment une femme?” [72] Cependant, au début de 1837, la mère de Maria Wodzińska avait clairement indiqué à Chopin dans une correspondance qu’il était peu probable qu’un mariage avec sa fille se poursuive. [73] On pense qu’elle a été influencée par sa mauvaise santé et peut-être aussi par des rumeurs sur ses associations avec des femmes telles que d’Agoult et Sand. [74]Chopin plaça finalement les lettres de Maria et de sa mère dans un paquet sur lequel il écrivit, en polonais, “Ma tragédie”. [75] Sand, dans une lettre à Grzymała de juin 1838, a admis des sentiments forts pour le compositeur et a débattu de l’opportunité d’abandonner une affaire en cours pour commencer une relation avec Chopin; elle a demandé à Grzymała d’évaluer la relation de Chopin avec Maria Wodzińska, sans se rendre compte que l’affaire, du moins du côté de Maria, était terminée. [76]
En juin 1837, Chopin visita Londres incognito en compagnie du fabricant de pianos Camille Pleyel, où il joua lors d’une soirée musicale chez le facteur de pianos anglais James Broadwood . [77] À son retour à Paris, son association avec Sand commença sérieusement et à la fin de juin 1838, ils étaient devenus amants. [78] Sand, qui avait six ans de plus que le compositeur et avait eu une série d’amants, écrit à cette époque : « Je dois dire que j’étais confus et étonné de l’effet que cette petite créature avait sur moi… J’ai encore pas remis de mon étonnement, et si j’étais une personne fière, je me sentirais humilié d’avoir été emporté … ” [79] Les deux ont passé un hiver misérable à Majorque(8 novembre 1838 au 13 février 1839), où, avec les deux enfants de Sand, ils avaient voyagé dans l’espoir d’améliorer la santé de Chopin et celle du fils de Sand , Maurice , âgé de 15 ans, et aussi pour échapper aux menaces de l’ancien amant de Sand. Félicien Mallefille . [80] Après avoir découvert que le couple n’était pas marié, le peuple catholique profondément traditionnel de Majorque est devenu inhospitalier, [81] rendant le logement difficile à trouver. Cela obligea le groupe à se loger dans un ancien monastère Chartreux de Valldemossa , peu à l’abri du froid de l’hiver. [78]

 Couture de George Sand , d’après le portrait conjoint de Delacroix de Chopin et Sand , 1838
Couture de George Sand , d’après le portrait conjoint de Delacroix de Chopin et Sand , 1838
Le 3 décembre 1838, Chopin se plaignit de sa mauvaise santé et de l’incompétence des médecins de Majorque, commentant : « Trois médecins m’ont rendu visite… Le premier a dit que j’étais mort ; le second a dit que j’étais mourant ; et le troisième a dit que je était sur le point de mourir.” [82] Il a également eu des problèmes pour se faire envoyer son piano Pleyel , devant compter entre-temps sur un piano fabriqué à Palma par Juan Bauza. [83] [n 13] Le piano Pleyel est finalement arrivé de Paris en décembre, peu de temps avant que Chopin et Sand ne quittent l’île. Chopin écrit à Pleyel en janvier 1839 : « Je vous envoie mes Préludes[Op. 28]. Je les ai terminés sur votre petit piano, qui est arrivé dans le meilleur état possible malgré la mer, le mauvais temps et les coutumes de Palma.” [78] Chopin a également pu entreprendre à Majorque des travaux sur sa Ballade n° 2 , Op. 38, sur deux Polonaises, Op. 40 et sur le Scherzo n° 3 , Op. 39. [84]
Bien que cette période ait été productive, le mauvais temps a eu un effet si néfaste sur la santé de Chopin que Sand a décidé de quitter l’île. Pour éviter d’autres droits de douane, Sand a vendu le piano à un couple français local, les Canuts. [84] [n 14] Le groupe se rendit d’abord à Barcelone , puis à Marseille , où ils restèrent quelques mois pendant la convalescence de Chopin. [86] Pendant son séjour à Marseille, Chopin fait une rare apparition à l’orgue lors d’une messe de requiem pour le ténor Adolphe Nourrit le 24 avril 1839, jouant une transcription du lied Die Gestirne (D. 444) de Franz Schubert . [87] [88] [n 15] En mai 1839, ils se rendirent au domaine de Sand à Nohant pour l’été, où ils passèrent la plupart des étés suivants jusqu’en 1846. À l’automne, ils retournèrent à Paris, où l’appartement de Chopin au 5 rue Tronchet était proche du logement loué par Sand sur la rue Pigalle. Il visitait fréquemment Sand le soir, mais tous deux conservaient une certaine indépendance. [90] (En 1842, Sand et lui s’installèrent au Square d’Orléans , vivant dans des bâtiments adjacents.) [91]
Le 26 juillet 1840, Chopin et Sand assistent à la répétition générale de la Grande symphonie funèbre et triomphale de Berlioz , composée pour commémorer le dixième anniversaire de la Révolution de Juillet . Chopin n’aurait pas été impressionné par la composition. [90] Pendant les étés à Nohant, en particulier dans les années 1839-1843, Chopin trouve des journées calmes et productives au cours desquelles il compose de nombreuses œuvres, dont sa Polonaise en la bémol majeur, op. 53 . Parmi les visiteurs de Nohant figuraient Delacroix et la mezzo-soprano Pauline Viardot , que Chopin avait conseillée sur la technique et la composition du piano. [92] Delacroix relate son séjour à Nohant dans une lettre du 7 juin 1842 :
Les hôtes ne pourraient pas être plus agréables pour me divertir. Lorsque nous ne sommes pas tous ensemble pour dîner, déjeuner, jouer au billard ou nous promener, chacun de nous reste dans sa chambre, à lire ou à se prélasser sur un canapé. Parfois, par la fenêtre qui s’ouvre sur le jardin, une bouffée de musique s’élève de Chopin au travail. Tout cela se mêle aux chants des rossignols et au parfum des roses. [93]
Déclin 
 Chopin par Gratia , 1838
Chopin par Gratia , 1838
A partir de 1842, Chopin montre des signes de maladie grave. Après un récital en solo à Paris le 21 février 1842, il écrit à Grzymała : “Je dois rester au lit toute la journée, j’ai tellement mal à la bouche et aux amygdales.” [94] Il fut contraint par la maladie de décliner une invitation écrite d’Alkan à participer à une répétition de l’arrangement de la 7e symphonie de Beethoven chez Érard le 1er mars 1843. [95] À la fin de 1844, Charles Hallé rendit visite à Chopin et le trouva “à peine capable de bouger, courbé comme un canif entr’ouvert et manifestement dans une grande douleur”, bien que ses esprits soient revenus quand il a commencé à jouer du piano pour son visiteur. [96]La santé de Chopin continue de se détériorer, surtout à partir de cette époque. La recherche moderne suggère qu’en dehors de toute autre maladie, il pourrait également avoir souffert d’ épilepsie du lobe temporal . [97]
La production de Chopin en tant que compositeur tout au long de cette période a diminué en quantité d’année en année. Alors qu’en 1841 il avait écrit une douzaine d’œuvres, six seulement furent écrites en 1842 et six plus courtes en 1843. En 1844, il n’écrivit que l’ op. 58 sonate . 1845 a vu l’achèvement de trois mazurkas (Op. 59). Bien que ces œuvres aient été plus raffinées que nombre de ses compositions antérieures, Zamoyski conclut que “ses pouvoirs de concentration étaient défaillants et que son inspiration était assaillie par l’angoisse, à la fois émotionnelle et intellectuelle”. [98] Les relations de Chopin avec Sand ont été aigries en 1846 par des problèmes impliquant sa fille Solange et le fiancé de Solange, le jeune sculpteur chasseur de fortune Auguste Clésinger . [99]Le compositeur a souvent pris le parti de Solange dans les querelles avec sa mère; il a également fait face à la jalousie du fils de Sand, Maurice. [100] De plus, Chopin était indifférent aux poursuites politiques radicales de Sand, y compris son enthousiasme pour la révolution de février 1848. [101]
Au fur et à mesure que la maladie du compositeur progressait, Sand était devenue moins une amante et plus une infirmière pour Chopin, qu’elle appelait son “troisième enfant”. Dans des lettres à des tiers, elle a exprimé son impatience, se référant à lui comme un «enfant», un «petit ange», un «pauvre ange», une «malade» et un «petit cadavre bien-aimé». [102] [103] En 1847, Sand publie son roman Lucrezia Floriani , dont les personnages principaux – une riche actrice et un prince en mauvaise santé – pourraient être interprétés comme Sand et Chopin. En présence de Chopin, Sand lut le manuscrit à haute voix à Delacroix, qui était à la fois choqué et mystifié par ses implications, écrivant que “Madame Sand était parfaitement à l’aise et Chopin ne pouvait guère s’empêcher de faire des commentaires admiratifs”.Cette année-là, leur relation a pris fin à la suite d’une correspondance colérique qui, selon les mots de Sand, a fait “une étrange conclusion à neuf ans d’amitié exclusive”. [106] Grzymała, qui avait suivi leur romance depuis le début, a commenté : « Si [Chopin] n’avait pas eu le malheur de rencontrer GS [George Sand], qui a empoisonné tout son être, il aurait vécu jusqu’à l’âge de Cherubini. Chopin mourra deux ans plus tard à trente-neuf ans ; le compositeur Luigi Cherubini était mort à Paris en 1842 à l’âge de quatre-vingt-un ans. [107]
Tour de Grande-Bretagne 
 Jane Stirling , par Devéria , ca. 1830
Jane Stirling , par Devéria , ca. 1830
La popularité publique de Chopin en tant que virtuose a commencé à décliner, tout comme le nombre de ses élèves, ce qui, combiné aux conflits politiques et à l’instabilité de l’époque, l’a amené à lutter financièrement. [108] En février 1848, avec le violoncelliste Auguste Franchomme , il donne son dernier concert parisien, qui comprend trois mouvements de la Sonate pour violoncelle op. 65 . [102]
En avril, lors de la Révolution de 1848 à Paris, il part pour Londres, où il donne plusieurs concerts et de nombreuses réceptions dans de grandes maisons. [102] Cette tournée lui a été suggérée par son élève écossaise Jane Stirling et sa sœur aînée. Stirling a également pris toutes les dispositions logistiques et fourni une grande partie du financement nécessaire. [106]
A Londres, Chopin s’installe à Dover Street , où la firme Broadwood lui fournit un piano à queue. Lors de son premier engagement, le 15 mai à Stafford House , le public comprenait la reine Victoria et le prince Albert . Le Prince, qui était lui-même un musicien talentueux, s’approcha du clavier pour voir la technique de Chopin. Broadwood a également organisé des concerts pour lui; parmi les participants figuraient l’auteur William Makepeace Thackeray et la chanteuse Jenny Lind . Chopin était également recherché pour des cours de piano, pour lesquels il facturait le prix élevé d’une guinéepar heure, et pour les récitals privés pour lesquels le tarif était de 20 guinées. Lors d’un concert le 7 juillet, il partage l’estrade avec Viardot, qui chante des arrangements de certaines de ses mazurkas sur des textes espagnols. [109] Le 28 août, il a joué lors d’un concert au Gentlemen’s Concert Hall de Manchester, partageant la scène avec Marietta Alboni et Lorenzo Salvi . [110]
À la fin de l’été, il fut invité par Jane Stirling à visiter l’Écosse, où il séjourna à Calder House près d’Édimbourg et au château de Johnstone dans le Renfrewshire , tous deux appartenant à des membres de la famille de Stirling. [111] Elle avait clairement l’idée d’aller au-delà de la simple amitié, et Chopin a été obligé de lui faire comprendre qu’il ne pouvait en être ainsi. Il écrivit à cette époque à Grzymała : “Mes dames écossaises sont gentilles, mais tellement ennuyeuses”, et répondant à une rumeur sur son implication, répondit qu’il était “plus près de la tombe que du lit nuptial”. [112] Il a donné un concert public à Glasgow le 27 septembre [113] et un autre à Édimbourg aux Hopetoun Rooms sur Queen Street (maintenant Erskine House) le 4 octobre.[114] Fin octobre 1848, alors qu’il séjournait au 10 Warriston Crescent à Édimbourg avec le médecin polonais Adam Łyszczyński, il rédigea ses dernières volontés et son testament – “une sorte de disposition à faire de mes affaires à l’avenir, si je devais tomber mort quelque part », écrit-il à Grzymała. [102]
Chopin fit sa dernière apparition publique sur une plate-forme de concert au Guildhall de Londres le 16 novembre 1848, lorsque, dans un dernier geste patriotique, il joua au profit des réfugiés polonais. Ce geste s’est avéré être une erreur, car la plupart des participants étaient plus intéressés par la danse et les rafraîchissements que par l’art du piano de Chopin, qui l’épuisait. [115] À ce moment-là, il était très gravement malade, pesant moins de 99 livres (moins de 45 kg), et ses médecins savaient que sa maladie était en phase terminale. [116]
Fin novembre, Chopin rentre à Paris. Il passa l’hiver dans une maladie incessante, mais donna des cours occasionnels et reçut la visite d’amis, dont Delacroix et Franchomme. Occasionnellement, il jouait ou accompagnait le chant de Delfina Potocka , pour ses amis. Au cours de l’été 1849, ses amis lui trouvent un appartement à Chaillot , en dehors du centre de la ville, dont le loyer est subventionné en secret par une admiratrice, la princesse Obreskoff. Il a été visité ici par Jenny Lind en juin 1849. [117]
Décès et funérailles

 Chopin sur son lit de mort , de Teofil Kwiatkowski , 1849, commandé par Jane Stirling . De gauche à droite : Aleksander Jełowicki ; Ludwika , la sœur de Chopin ; Marcelina Czartoryska ; Wojciech Grzymala ; Kwiatkowski.
Chopin sur son lit de mort , de Teofil Kwiatkowski , 1849, commandé par Jane Stirling . De gauche à droite : Aleksander Jełowicki ; Ludwika , la sœur de Chopin ; Marcelina Czartoryska ; Wojciech Grzymala ; Kwiatkowski. 


 Le masque mortuaire de Chopin, par Clésinger (photos : Jack Gibbons )
Le masque mortuaire de Chopin, par Clésinger (photos : Jack Gibbons )
Sa santé se détériorant davantage, Chopin souhaitait avoir un membre de sa famille avec lui. En juin 1849, sa sœur Ludwika vient à Paris avec son mari et sa fille, et en septembre, soutenu par un prêt de Jane Stirling, il prend un appartement à l’ hôtel Baudard de Saint-James [n 16] sur la place Vendôme . [118] Après le 15 octobre, lorsque son état s’est nettement détérioré, seule une poignée de ses amis les plus proches sont restés avec lui. Viardot remarqua cependant avec ironie que “toutes les grandes dames parisiennes considéraient qu’il était de rigueur de s’évanouir dans sa chambre”. [116]
Certains de ses amis ont fourni de la musique à sa demande; parmi eux, Potocka chantait et Franchomme jouait du violoncelle. Chopin a légué ses notes inachevées sur une méthode d’enseignement du piano, Projet de méthode , à Alkan pour qu’il les complète. [119] Le 17 octobre, après minuit, le médecin se pencha sur lui et lui demanda s’il souffrait beaucoup. « Plus maintenant », a-t-il répondu. Il est mort quelques minutes avant deux heures du matin. Il avait 39 ans. Les personnes présentes au lit de mort semblent avoir inclus sa sœur Ludwika, le père. Aleksander Jełowicki , la princesse Marcelina Czartoryska, la fille de Sand, Solange, et son ami proche Thomas Albrecht. Plus tard dans la matinée, le mari de Solange, Clésinger, a fabriqué le masque mortuaire de Chopin et un moulage de sa main gauche. [120]
Les funérailles, tenues à l’ église de la Madeleine à Paris, ont été retardées de près de deux semaines jusqu’au 30 octobre. L’entrée était réservée aux détenteurs de billets, car de nombreuses personnes étaient attendues. [121] Plus de 3 000 personnes sont arrivées sans invitation, d’aussi loin que Londres, Berlin et Vienne, et ont été exclues. [122]
Le Requiem de Mozart a été chanté lors des funérailles; les solistes étaient la soprano Jeanne-Anaïs Castellan , la mezzo-soprano Pauline Viardot, le ténor Alexis Dupont et la basse Luigi Lablache ; Les Préludes n° 4 en mi mineur et n° 6 en si mineur de Chopin ont également été joués. L’organiste était Louis Lefébure-Wély . Le cortège funèbre au cimetière du Père Lachaise , qui comprenait la sœur de Chopin, Ludwika, était dirigé par le vieux prince Adam Czartoryski . Les porteurs comprenaient Delacroix, Franchomme et Camille Pleyel. [123] Sur la tombe, la Marche funèbre de la Sonate pour piano n° 2 de Chopin a été jouée, enL’instrumentation de Reber . [124]
La pierre tombale de Chopin, représentant la muse de la musique, Euterpe , pleurant sur une lyre brisée , a été conçue et sculptée par Clésinger et installée le jour anniversaire de sa mort en 1850. Les dépenses du monument, d’un montant de 4 500 francs, ont été couvertes par Jane Stirling , qui a également payé le retour de la sœur du compositeur Ludwika à Varsovie. [125] A la demande de Chopin, Ludwika ramène son cœur (qui avait été prélevé par son médecin Jean Cruveilhier et conservé dans l’alcool dans un vase) en Pologne en 1850. [ 126] [127] [n 17] recueil de deux cents lettres de Sand à Chopin ; après 1851, ceux-ci furent rendus à Sand, qui les détruisit.[130]
La maladie de Chopin et la cause de sa mort ont fait l’objet de discussions. Son certificat de décès indiquait que la cause du décès était la tuberculose , et son médecin, Cruveilhier, était alors la principale autorité française sur cette maladie. [131] D’autres possibilités qui ont été avancées ont inclus la fibrose kystique , [132] la cirrhose et le déficit en alpha 1-antitrypsine . [133] [134] Un examen visuel du cœur préservé de Chopin (le pot n’a pas été ouvert), réalisé en 2014 et publié pour la première fois dans l’ American Journal of Medicine en 2017, a suggéré que la cause probable de sa mort était un cas rare de péricarditecausées par des complications de la tuberculose chronique. [135] [136] [137]
Musique
| Mazurka en la mineur, op. 17, n° 4 ( 4 : 25 ) 4:26 Giorgi Latso , piano
Valse en ré bémol majeur, op. 64, n° 1 (dite Valse minute ) ( 2 : 00 ) 2:01 Muriel Nguyen Xuan, piano Étude Op. 10, n° 12 (soi-disant Révolutionnaire ) ( 2 : 44 ) 2:45 Martha Goldstein jouant un piano Érard de 1851 Prélude en ré bémol majeur, op. 28, n° 15 (soi-disant Goutte de pluie ) ( 5 : 14 ) 5:15 Giorgi Latso , piano Scherzo n° 3, op. 39 en do dièse mineur ( 6 : 32 ) 6:32 Martha Argerich , piano Ballade n° 4, op. 52 en fa mineur ( 11 : 17 ) 11:17 Randolph Hokanson , piano |
|
Problèmes de lecture de ces fichiers ? Voir l’aide aux médias . |
Aperçu
Plus de 230 œuvres de Chopin survivent; certaines compositions de la petite enfance ont été perdues. Toutes ses œuvres connues impliquent le piano, et seules quelques-unes vont au-delà de la musique pour piano solo , sous forme de concertos pour piano , de chansons ou de musique de chambre . [138]
Chopin a été éduqué dans la tradition de Beethoven, Haydn, Mozart et Clementi ; il a utilisé la méthode de piano de Clementi avec ses élèves. Il a également été influencé par le développement par Hummel de la technique pianistique virtuose, mais mozartienne. Il a cité Bach et Mozart comme les deux compositeurs les plus importants pour façonner sa vision musicale. [139] Les premières œuvres de Chopin sont dans le style des pièces pour clavier “brillantes” de son époque, comme en témoignent les œuvres d’ Ignaz Moscheles , de Friedrich Kalkbrenner et d’autres. Moins directes dans la période antérieure sont les influences de la musique folklorique polonaise et de l’opéra italien . Une grande partie de ce qui est devenu son style typique d’ornementation (par exemple, sonfioriture ) est tiré du chant. Ses lignes mélodiques rappelaient de plus en plus les modes et les caractéristiques de la musique de son pays natal, comme les drones . [140]
Chopin a amené le nouveau genre de salon du nocturne , inventé par le compositeur irlandais John Field , à un niveau de sophistication plus profond. Il fut le premier à écrire des ballades [141] et des scherzos en tant que pièces de concert individuelles. Il a essentiellement établi un nouveau genre avec son propre ensemble de préludes autonomes (Op. 28, publié en 1839). Il exploite le potentiel poétique du concept d’ étude de concert , déjà développé dans les années 1820 et 1830 par Liszt, Clementi et Moscheles, dans ses deux recueils d’études (Op. 10 publié en 1833, Op. 25 en 1837). [142]
Chopin a également doté les formes de danse populaire d’une plus grande gamme de mélodies et d’expressions. Les mazurkas de Chopin , tout en étant originaires de la danse traditionnelle polonaise (le mazurek ), différaient de la variété traditionnelle en ce qu’elles étaient écrites pour la salle de concert plutôt que pour la salle de danse ; comme le dit J. Barrie Jones, “c’est Chopin qui a mis la mazurka sur la carte musicale européenne”. [143] La série de sept polonaises publiées de son vivant (neuf autres ont été publiées à titre posthume), en commençant par l’op. 26 paires (publié en 1836), a établi une nouvelle norme pour la musique sous la forme. [144] Ses valsesont également été écrits spécifiquement pour le récital de salon plutôt que pour la salle de bal et sont souvent à des tempos plutôt plus rapides que leurs équivalents de piste de danse. [145]
Titres, numéros d’opus et éditions

 Citation musicale dédicacée de la Polonaise op. 53 , signé par Chopin le 25 mai 1845
Citation musicale dédicacée de la Polonaise op. 53 , signé par Chopin le 25 mai 1845
Certaines des pièces bien connues de Chopin ont acquis des titres descriptifs, tels que l’ Étude révolutionnaire (Op. 10, n° 12) et la Valse minute (Op. 64, n° 1). Cependant, à l’exception de sa Marche funèbre , le compositeur n’a jamais nommé une œuvre instrumentale au-delà du genre et du nombre, laissant toutes les associations extramusicales potentielles à l’auditeur ; les noms sous lesquels plusieurs de ses pièces sont connues ont été inventés par d’autres. [146] [147] Il n’y a aucune preuve pour suggérer que l’ Étude Révolutionnaire a été écrite avec le soulèvement polonais raté contre la Russie à l’esprit; il est simplement apparu à ce moment-là. [148] La marche funèbre, le troisième mouvement de sa Sonate n ° 2 (Op. 35), le seul cas où il a donné un titre, a été écrit avant le reste de la sonate, mais aucun événement ou décès spécifique n’est connu pour l’avoir inspiré. [149]
Le dernier numéro d’opus utilisé par Chopin lui-même était le 65, attribué à la Sonate pour violoncelle en sol mineur. Il a exprimé le souhait de son lit de mort que tous ses manuscrits non publiés soient détruits. À la demande de la mère et des sœurs du compositeur, cependant, son exécuteur testamentaire musical Julian Fontana sélectionna 23 pièces pour piano inédites et les regroupa en huit autres numéros d’opus (Opp. 66-73), publiés en 1855. [150] En 1857, 17 pièces polonaises les chansons que Chopin a écrites à différentes étapes de sa vie ont été rassemblées et publiées sous le nom d’op. 74, bien que leur ordre dans l’opus ne reflète pas l’ordre de composition. [151]
Les œuvres publiées depuis 1857 ont reçu des désignations de catalogue alternatives au lieu des numéros d’opus. Le catalogue le plus à jour est maintenu par l’ Institut Fryderyk Chopin dans son Internet Chopin Information Center. L’ancien catalogue Kobylańska (généralement représenté par les initiales « KK »), du nom de son compilateur, la Musicologue polonaise Krystyna Kobylańska , est toujours considéré comme une référence scientifique importante. Le catalogue le plus récent d’œuvres publiées à titre posthume est celui de l’ Édition nationale des Œuvres de Frédéric Chopin , représenté par les initiales « WN ». [152]
Les éditeurs originaux de Chopin comprenaient Maurice Schlesinger et Camille Pleyel. [153] Ses travaux ont commencé bientôt à apparaître dans les anthologies populaires de piano du 19ème siècle. [154] La première édition collectée était par Breitkopf & Härtel (1878–1902). [155] Parmi les éditions savantes modernes des œuvres de Chopin figurent la version sous le nom de Paderewski , publiée entre 1937 et 1966, et la plus récente Édition nationale polonaise , éditée par Jan Ekier et publiée entre 1967 et 2010. Cette dernière est recommandée aux candidats. du Concours Chopin . [156]Les deux éditions contiennent des explications détaillées et des discussions concernant les choix et les sources. [157] [158]
Chopin a publié sa musique en France, en Angleterre et dans les États allemands en raison des lois sur le droit d’auteur de l’époque. En tant que tel, il existe souvent trois types différents de “premières éditions”. Chaque édition est différente de l’autre, car Chopin les a éditées séparément et parfois il a fait quelques révisions de la musique tout en l’éditant. En outre, Chopin a fourni à ses éditeurs diverses sources, notamment des autographes, des épreuves annotées et des copies de scribes. Ce n’est que récemment que ces différences ont été davantage reconnues. [159]
Forme et harmonie

 Une reconstitution de la dernière demeure du compositeur place Vendôme , au Salon Frédéric Chopin , Paris. [160] [n 18]
Une reconstitution de la dernière demeure du compositeur place Vendôme , au Salon Frédéric Chopin , Paris. [160] [n 18]
L’ improvisation est au centre des processus créatifs de Chopin. Cependant, cela n’implique pas une divagation impulsive: Nicholas Temperley écrit que «l’improvisation est conçue pour un public, et son point de départ est les attentes de ce public, qui incluent les conventions actuelles de la forme musicale». [161] Les œuvres pour piano et orchestre, y compris les deux concertos, sont tenues par Temperley pour être “simplement des véhicules pour un jeu de piano brillant … formellement de longue haleine et extrêmement conservateur”. [162]Après les concertos pour piano (tous deux anciens, datant de 1830), Chopin n’a pas tenté de grandes formes à plusieurs mouvements, à l’exception de ses dernières sonates pour piano et violoncelle ; “au lieu de cela, il a atteint la quasi-perfection dans des pièces de conception générale simple mais à structure cellulaire subtile et complexe.” [163] Rosen suggère qu’un aspect important de l’individualité de Chopin est sa manipulation flexible de la phrase à quatre mesures en tant qu’unité structurelle. [164]
J. Barrie Jones suggère que “parmi les œuvres que Chopin destinait au concert, les quatre ballades et les quatre scherzos sont suprêmes”, et ajoute que “la Barcarolle Op. 60 se distingue comme un exemple de la riche palette harmonique de Chopin couplée à un Italianate chaleur de la mélodie.” [165] Temperley est d’avis que ces œuvres, qui contiennent “une immense variété d’ambiances, de matériaux thématiques et de détails structurels”, sont basées sur une forme étendue de “départ et retour” ; “plus la section médiane est étendue, et plus elle s’éloigne de l’idée d’ouverture dans la tonalité, l’ambiance et le thème, plus la reprise est importante et dramatique lorsqu’elle arrive enfin.” [166]
Les mazurkas et les valses de Chopin sont toutes de forme ternaire ou épisodique simple, parfois avec une coda . [143] [166] Les mazurkas montrent souvent plus de caractéristiques folkloriques que beaucoup de ses autres œuvres, incluant parfois des gammes et des harmonies modales et l’utilisation de basses bourdonnantes. Cependant, certains montrent également une sophistication inhabituelle, par exemple, Op. 63 n° 3, qui comprend un canon à un temps de distance, une grande rareté en musique. [167]
Les polonaises de Chopin montrent une nette avance sur celles de ses prédécesseurs polonais dans la forme (qui comprenaient ses professeurs Żywny et Elsner). Comme pour la polonaise traditionnelle, les œuvres de Chopin sont à trois temps et affichent généralement un rythme martial dans leurs mélodies, accompagnements et cadences. Contrairement à la plupart de leurs prédécesseurs, ils nécessitent également une technique de jeu redoutable. [168]
Les 21 nocturnes sont plus structurés et d’une plus grande profondeur émotionnelle que ceux de Field, que Chopin rencontra en 1833. De nombreux nocturnes de Chopin ont des sections médianes marquées par une expression agitée (et faisant souvent des demandes très difficiles à l’interprète), ce qui accentue leur caractère dramatique. [169]
Les études de Chopin sont en grande partie sous forme ternaire simple. [170] Il les a utilisés pour enseigner sa propre technique de jeu de piano; [171] – par exemple en jouant des doubles tierces ( Op. 25, n° 6 ), en jouant en octaves ( Op. 25, n° 10 ) et en jouant des notes répétées ( Op. 10, n° 7 ). [172]
Les préludes , dont beaucoup sont très brefs (certains consistant en de simples énoncés et développements d’un thème ou d’une figure unique), ont été décrits par Schumann comme “les débuts des études”. [173] Inspirés du Clavier bien tempéré de JS Bach , les préludes de Chopin remontent le cercle des quintes (plutôt que la séquence de gamme chromatique de Bach ) pour créer un prélude dans chaque tonalité majeure et mineure. [174] Les préludes n’étaient peut-être pas destinés à être joués en groupe, et peuvent même avoir été utilisés par lui et des pianistes ultérieurs comme préludes génériques à d’autres de ses pièces, ou même à la musique d’autres compositeurs. Ceci est suggéré par Kenneth Hamilton , qui a noté un enregistrement de 1922 parFerruccio Busoni dans lequel le Prélude op. 28 n° 7 est suivi de l’ Étude op. 10 n° 5 . [175]
Les deux sonates pour piano de Chopin ( n° 2 , op. 35, écrite en 1839 et n° 3, op. 58, écrite en 1844) sont en quatre mouvements. Dans Op. 35, Chopin a pu combiner au sein d’une grande structure musicale formelle de nombreux éléments de sa technique pianistique virtuose – “une sorte de dialogue entre le pianisme public du style brillant et le principe de la sonate allemande”. [176] Cette sonate a été considérée comme montrant les influences de Bach et de Beethoven. Le Prélude de la Suite n° 6 en ré majeur pour violoncelle de Bach (BWV 1012) est cité ; [177] et il y a des références à deux sonates de Beethoven : la Sonate Opus 111 en ut mineur, et la Sonate Opus 26en la bémol majeur, qui, comme l’op. 35, a une marche funèbre comme mouvement lent. [178] [179] Le dernier mouvement de l’op. 35, un bref mobile perpétuel (75 mesures) dans lequel les mains jouent à l’unisson d’une octave non modifiée, a été trouvé choquant et non musical par des contemporains, dont Schumann. [180] L’op. La sonate 58 se rapproche de la tradition allemande, comprenant de nombreux passages de contrepoint complexe , “digne de Brahms ” selon Samson. [176]
Les innovations harmoniques de Chopin peuvent provenir en partie de sa technique d’improvisation au clavier. Dans ses œuvres, dit Temperley, de nouveaux effets harmoniques résultent souvent de la combinaison d’ appoggiatures ordinaires ou de notes de passage avec des figures mélodiques d’accompagnement “, et les cadences sont retardées par l’utilisation d’accords en dehors de la tonalité d’origine ( sixtes napolitaines et septièmes diminuées ) ou par changements soudains vers des touches distantes. Les progressions d’ accords anticipent parfois la tonalité changeante de compositeurs ultérieurs tels que Claude Debussy , tout comme l’utilisation par Chopin de l’harmonie modale. [181]
Technique et style de performance

 Extrait du Nocturne op. 62 non. 1 (1846, manuscrit du compositeur)
Extrait du Nocturne op. 62 non. 1 (1846, manuscrit du compositeur) 
 Le même passage ( édition Schirmer de 1881 ). Les exemples montrent l’utilisation typique par Chopin des trilles , des appoggiatures et des instructions détaillées de pédalage et de tempo .
Le même passage ( édition Schirmer de 1881 ). Les exemples montrent l’utilisation typique par Chopin des trilles , des appoggiatures et des instructions détaillées de pédalage et de tempo .
En 1841 , Léon Escudier écrit à propos d’un récital donné par Chopin cette année-là : « On peut dire que Chopin est le créateur d’une école de piano et d’une école de composition. En vérité, rien n’égale la légèreté, la douceur avec lesquelles le compositeur prélude à le piano; d’ailleurs rien n’est comparable à ses oeuvres pleines d’originalité, de distinction et de grâce.” [182] Chopin a refusé de se conformer à une méthode standard de jeu et croyait qu’il n’y avait pas de technique établie pour bien jouer. Son style reposait largement sur son utilisation d’une technique de doigt très indépendante. Dans son Projet de méthode , il écrit : “Tout est une question de savoir bien doigter… il n’en faut pas moins pour utiliser le reste de la main, le poignet, l’avant-bras et le haut du bras.” [183]Il précise encore : « Il suffit d’étudier une certaine position de la main par rapport aux touches pour obtenir avec aisance la plus belle qualité de son, savoir jouer des notes courtes et des notes longues, et [atteindre] une dextérité illimitée. .” [184] Les conséquences de cette approche de la technique dans la musique de Chopin incluent l’utilisation fréquente de toute la gamme du clavier, des passages en doubles octaves et autres groupements d’accords, des notes rapidement répétées, l’utilisation de notes de grâce et l’utilisation de rythmes contrastés. (quatre contre trois, par exemple) entre les mains. [185]
Jonathan Bellman écrit que le style de performance de concert moderne – situé dans la tradition « conservatoire » des écoles de musique de la fin des XIXe et XXe siècles, et adapté aux grands auditoriums ou aux enregistrements – milite contre ce que l’on sait de la technique de performance plus intime de Chopin. [186] Le compositeur lui-même a dit à un élève que “les concerts ne sont jamais de la vraie musique, il faut renoncer à y entendre toutes les plus belles choses de l’art”. [187] Les récits contemporains indiquent que dans l’interprétation, Chopin évitait les procédures rigides qui lui étaient parfois attribuées à tort, telles que “toujours crescendo jusqu’à une note aiguë”, mais qu’il se souciait du phrasé expressif, de la cohérence rythmique et de la coloration sensible. [188]Berlioz écrivait en 1853 que Chopin “a créé une sorte de broderie chromatique … dont l’effet est si étrange et piquant qu’il est impossible de le décrire … pratiquement personne d’autre que Chopin lui-même ne peut jouer cette musique et lui donner cette tournure inhabituelle”. [189] Hiller a écrit que “ce qui dans les mains des autres était un embellissement élégant, dans ses mains est devenu une couronne de fleurs colorées.” [190]
La musique de Chopin est fréquemment jouée avec le rubato , “la pratique de l’interprétation consistant à ne pas tenir compte du temps strict, à” voler “certaines valeurs de note pour un effet expressif”. [191] Il existe des opinions divergentes quant à la quantité et au type de rubato approprié pour ses œuvres. Charles Rosen commente que “la plupart des indications écrites de rubato chez Chopin se trouvent dans ses mazurkas … Il est probable que Chopin ait utilisé l’ancienne forme de rubato si importante pour Mozart … [où] la note mélodique dans la main droite est retardé jusqu’après la note dans la basse … Une forme alliée de ce rubato est l’ arpégiation des accords retardant ainsi la note mélodique; selon Chopin ‘, Chopin était fermement opposé à cette pratique.” [192]
L’élève de Chopin, Friederike Müller, a écrit :
[Son] jeu a toujours été noble et beau ; ses tonalités chantaient, que ce soit au piano fort ou au piano le plus doux . Il s’est donné beaucoup de mal pour enseigner à ses élèves ce style de jeu legato , cantabile . Sa critique la plus sévère était « Il – ou elle – ne sait pas joindre deux notes ». Il a également exigé le respect le plus strict du rythme. Il détestait tous les rubatos traînants et traînants, déplacés , ainsi que les ritardandos exagérés […] et c’est précisément à cet égard que les gens commettent de si terribles erreurs en jouant ses œuvres. [193]
Instruments


Lorsqu’il vivait à Varsovie, Chopin composait et jouait sur un instrument construit par le facteur de pianos Fryderyk Buchholtz . [194] [n 19] Plus tard à Paris, Chopin acheta un piano à Pleyel . Il a qualifié les pianos de Pleyel de “non plus ultra” (“rien de mieux”). [197] Franz Liszt s’est lié d’amitié avec Chopin à Paris et a décrit le son du Pleyel de Chopin comme étant « le mariage du cristal et de l’eau ». [198] Alors qu’il est à Londres en 1848, Chopin mentionne ses pianos dans ses lettres : “J’ai un grand salon avec trois pianos, un Pleyel, un Broadwood et un Erard .” [197]
Identité polonaise
Avec ses mazurkas et ses polonaises, Chopin a été crédité d’avoir introduit dans la musique un nouveau sens du nationalisme . Schumann, dans sa critique des concertos pour piano de 1836, souligna les sentiments profonds du compositeur pour sa Pologne natale, écrivant que « Maintenant que les Polonais sont en profond deuil [après l’échec du soulèvement de novembre 1830], leur attrait pour nous, les artistes, est encore plus fort … Si le puissant autocrate du nord [c’est-à-dire Nicolas Ier de Russie ] pouvait savoir que dans les œuvres de Chopin, dans les simples accords de ses mazurkas, se cache un ennemi dangereux, il interdirait sa musique. les oeuvres sont des canons enterrés dans les fleurs !”Carolyne zu Sayn-Wittgenstein ) [200] affirme que Chopin “doit être classé premier parmi les premiers musiciens… individualisant en eux-mêmes le sens poétique de toute une nation”. [201]
|
Le « caractère polonais » de l’œuvre de Chopin est incontestable ; non pas parce qu’il écrivait aussi des polonaises et des mazurkas … dont les formes … étaient souvent bourrées de contenus idéologiques et littéraires étrangers venus de l’extérieur. … En tant qu’artiste, il a recherché des formes qui se démarquent du caractère littéraire et dramatique de la musique qui était une caractéristique du romantisme, en tant que Polonais, il a reflété dans son travail l’essence même de la rupture tragique dans l’histoire du peuple et aspirait instinctivement à donner l’expression la plus profonde de sa nation … Car il comprenait qu’il ne pouvait investir sa musique des qualités les plus durables et véritablement polonaises qu’en libérant l’art des limites des contenus dramatiques et historiques. Cette attitude envers la question de la “musique nationale” – une solution inspirée à son art – était la raison pour laquelle Chopin’ |
| Karol Szymanowski , 1923 [202] |
Certains commentateurs modernes se sont opposés à l’exagération de la primauté de Chopin en tant que compositeur « nationaliste » ou « patriotique ». George Golos fait référence à d’anciens compositeurs “nationalistes” d’Europe centrale, dont les Polonais Michał Kleofas Ogiński et Franciszek Lessel , qui utilisaient les formes polonaise et mazurka. [203] Barbara Milewski suggère que l’expérience de Chopin de la musique polonaise est venue plus des versions « urbanisées » de Varsovie que de la musique folklorique, et que les tentatives de Jachimecki et d’autres de démontrer la véritable musique folklorique dans ses œuvres sont sans fondement. [204] Richard Taruskin conteste l’attitude de Schumann envers les œuvres de Chopin comme condescendante, [205]et commente que Chopin “a ressenti profondément et sincèrement son patriotisme polonais” mais a consciemment modelé ses œuvres sur la tradition de Bach, Beethoven, Schubert et Field. [206] [207]
Une réconciliation de ces points de vue est suggérée par William Atwood : « Sans aucun doute, l’utilisation [par Chopin] de formes musicales traditionnelles comme la polonaise et la mazurka a suscité des sentiments nationalistes et un sentiment de cohésion parmi ces Polonais dispersés à travers l’Europe et le Nouveau Monde… Tandis que certains cherchaient réconfort en [eux], d’autres y ont trouvé une source de force dans leur lutte continue pour la liberté.Bien que la musique de Chopin lui soit sans aucun doute venue intuitivement plutôt que par un dessein patriotique conscient, elle a tout de même servi à symboliser la volonté du peuple polonais. ..” [208]
Réception et influence


Jones commente que “la position unique de Chopin en tant que compositeur, malgré le fait que pratiquement tout ce qu’il a écrit était pour le piano, a rarement été remise en question.” [170] Il note également que Chopin a eu la chance d’arriver à Paris en 1831 – “l’environnement artistique, les éditeurs qui étaient prêts à imprimer sa musique, les riches et les aristocrates qui ont payé ce que Chopin a demandé pour leurs leçons” – et ces facteurs, ainsi que son génie musical, ont également alimenté sa réputation contemporaine et ultérieure. [145] Alors que sa maladie et ses amours se conforment à certains des stéréotypes du romantisme , la rareté de ses récitals publics (par opposition aux représentations lors de soirées parisiennes à la mode) a conduit Arthur Hutchings à suggérer que “son manque de Byronicsa flamboyance [et] sa solitude aristocratique le rendent exceptionnel » parmi ses contemporains romantiques tels que Liszt et Henri Herz. [163]
Les qualités de Chopin en tant que pianiste et compositeur ont été reconnues par nombre de ses collègues musiciens. Schumann a nommé une pièce pour lui dans sa suite Carnaval , et Chopin a ensuite dédié sa Ballade n° 2 en fa majeur à Schumann. Des éléments de la musique de Chopin peuvent être trouvés dans de nombreuses œuvres ultérieures de Liszt. [70] Liszt a transcrit plus tard pour le piano six des chansons polonaises de Chopin. Une amitié moins tendue était avec Alkan, avec qui il a discuté d’éléments de musique folklorique, et qui a été profondément affecté par la mort de Chopin. [209]
A Paris, Chopin a eu plusieurs élèves, dont Friedericke Müller, qui a laissé des mémoires de son enseignement [210] et le prodige Carl Filtsch (1830-1845), à qui Chopin et Sand se sont dédiés, Chopin lui donnant trois leçons par semaine. ; Filtsch est le seul élève à qui Chopin donne des cours de composition et, exceptionnellement, il partage à plusieurs reprises avec lui une estrade de concert. [211] Deux des élèves de longue date de Chopin, Karol Mikuli (1821-1897) et Georges Mathias (1826-1910), étaient eux-mêmes professeurs de piano et transmettaient des détails sur son jeu à leurs élèves, dont certains (comme Raoul Koczalski) devait faire des enregistrements de sa musique. D’autres pianistes et compositeurs influencés par le style de Chopin incluent Louis Moreau Gottschalk , Édouard Wolff (1816–1880) et Pierre Zimmermann. [212] Debussy a dédié ses propres Études pour piano de 1915 à la mémoire de Chopin ; il joua fréquemment la musique de Chopin pendant ses études au Conservatoire de Paris , et entreprit l’édition de la musique pour piano de Chopin pour l’éditeur Jacques Durand . [213]

 Monument Frédéric Chopin , Parc Łazienki , Varsovie, conçu par Wacław Szymanowski
Monument Frédéric Chopin , Parc Łazienki , Varsovie, conçu par Wacław Szymanowski
Les compositeurs polonais de la génération suivante comprenaient des virtuoses tels que Moritz Moszkowski ; mais, de l’avis de J. Barrie Jones, son “un digne successeur” parmi ses compatriotes était Karol Szymanowski (1882-1937). [214] Edvard Grieg , Antonín Dvořák , Isaac Albéniz , Piotr Ilitch Tchaïkovski et Sergei Rachmaninoff , entre autres, sont considérés par les critiques comme ayant été influencés par l’utilisation par Chopin des modes et idiomes nationaux. [215] Alexander Scriabin a été consacré à la musique de Chopin et ses premiers travaux publiés incluent dix-neuf mazurkas aussi bien que de nombreuses études et préludes; son professeurNikolai Zverev l’a formé dans les œuvres de Chopin pour améliorer sa virtuosité d’interprète. [216] Au XXe siècle, les compositeurs qui ont rendu hommage (ou dans certains cas parodié) à la musique de Chopin comprenaient George Crumb , Leopold Godowsky , Bohuslav Martinů , Darius Milhaud , Igor Stravinsky , [217] et Heitor Villa-Lobos . [218]
La musique de Chopin a été utilisée dans le ballet Chopiniana de 1909 , chorégraphié par Michel Fokine et orchestré par Alexander Glazunov . Sergei Diaghilev a commandé des orchestrations supplémentaires – de Stravinsky, Anatoly Lyadov , Sergei Taneyev et Nikolai Tcherepnin – pour des productions ultérieures, qui ont utilisé le titre Les Sylphides . [219] D’autres compositeurs renommés ont créé des orchestrations pour le ballet, notamment Benjamin Britten , Roy Douglas , Alexander Gretchaninov , Gordon Jacob et Maurice Ravel ., [220] dont le score est perdu. [221]
La Musicologue Erinn Knyt écrit : « Au XIXe siècle, Chopin et sa musique étaient généralement considérés comme efféminés, androgynes, puérils, maladifs et « ethniquement autres ». » [222] L’historien de la musique Jeffrey Kallberg dit qu’à l’époque de Chopin, « les auditeurs du genre du nocturne pour piano ont souvent exprimé leurs réactions dans l’imagerie féminine », et il cite de nombreux exemples de telles réactions aux nocturnes de Chopin. [223] L’une des raisons à cela peut être «démographique» – il y avait plus de femmes que de pianistes masculins, et jouer de telles pièces «romantiques» était considéré par les critiques masculins comme un passe-temps domestique féminin. Une telle gendérisation n’était pas couramment appliquée à d’autres genres parmi les œuvres de Chopin, comme le scherzo ou la polonaise.a cité les démonstrations du pianiste et écrivain Charles Rosen , dans le livre de ce dernier The Romantic Generation , des compétences de Chopin en “planification, polyphonie et pure créativité harmonique”, renversant aussi efficacement toute légende de Chopin “qu’un pâmoison,” inspiré “, petit compositeur de salon”. [225] [226]
La musique de Chopin reste très populaire et est régulièrement interprétée, enregistrée et diffusée dans le monde entier. Le concours musical monographique le plus ancien au monde, le Concours international de piano Chopin , fondé en 1927, se tient tous les cinq ans à Varsovie. [227] L’ Institut Fryderyk Chopin de Pologne répertorie sur son site Web plus de quatre-vingts sociétés dans le monde consacrées au compositeur et à sa musique. [228] Le site de l’Institut répertorie également plus de 1500 représentations d’œuvres de Chopin sur YouTube en mars 2021 [update]. [229]
Enregistrements
La British Library note que “les œuvres de Chopin ont été enregistrées par tous les grands pianistes de l’ère de l’enregistrement”. Le premier enregistrement était une interprétation de 1895 par Paul Pabst du Nocturne en mi majeur, op. 62, n° 2 . Le site de la British Library met à disposition un certain nombre d’enregistrements historiques, dont certains d’ Alfred Cortot , Ignaz Friedman , Vladimir Horowitz , Benno Moiseiwitsch , Ignacy Jan Paderewski , Arthur Rubinstein , Xaver Scharwenka , Josef Hofmann , Vladimir de Pachmann , Moriz Rosenthalet plein d’autres. [230] Une discographie sélective d’enregistrements d’œuvres de Chopin par des pianistes représentant les diverses traditions pédagogiques issues de Chopin est donnée par James Methuen-Campbell dans son ouvrage retraçant la lignée et le caractère de ces traditions. [231]
De nombreux enregistrements des œuvres de Chopin sont disponibles. À l’occasion du bicentenaire du compositeur, les critiques du New York Times ont recommandé des interprétations des pianistes contemporains suivants (parmi beaucoup d’autres) : [232] Martha Argerich , Vladimir Ashkenazy , Emanuel Ax , Evgeny Kissin , Ivan Moravec , Murray Perahia , Maurizio Pollini et Krystian Zimerman . La Société Chopin de Varsovie organise le Grand prix du disque de F. Chopin pour les enregistrements Chopin notables, qui a lieu tous les cinq ans. [233]
Dans la littérature, la scène, le cinéma et la télévision

 Tombe de Chopin, cimetière du Père-Lachaise , Paris
Tombe de Chopin, cimetière du Père-Lachaise , Paris
Chopin a beaucoup figuré dans la littérature polonaise, à la fois dans des études critiques sérieuses de sa vie et de sa musique et dans des traitements de fiction. La première manifestation était probablement un sonnet de 1830 sur Chopin par Leon Ulrich. Les écrivains français sur Chopin (en dehors de Sand) ont inclus Marcel Proust et André Gide , et il a également figuré dans les œuvres de Gottfried Benn et Boris Pasternak . [234] Il existe de nombreuses biographies de Chopin en anglais (voir la bibliographie pour certaines d’entre elles).
Peut-être que la première aventure dans les traitements fictifs de la vie de Chopin était une version lyrique fantaisiste de certains de ses événements : Chopin . Produite pour la première fois à Milan en 1901, la musique – basée sur celle de Chopin – a été assemblée par Giacomo Orefice , avec un livret d’ Angiolo Orvieto [ it ] . [235] [236]
La vie et les tribulations amoureuses de Chopin ont été romancées dans de nombreux films. [237] Dès 1919, les relations de Chopin avec trois femmes – sa petite amie de jeunesse Mariolka, puis avec la chanteuse polonaise Sonja Radkowska, et plus tard avec George Sand – sont dépeintes dans le film muet allemand Nocturno der Liebe (1919), avec la musique de Chopin au service en toile de fond. [238] Le film biographique de 1945 A Song to Remember a valu à Cornel Wilde une nomination aux Oscars en tant que meilleur acteur pour son interprétation du compositeur. D’autres traitements cinématographiques ont inclus : La valse de l’adieu (France, 1928) d’ Henry Roussel , avec Pierre Blanchar dans le rôle de Chopin ;Impromptu (1991), avec Hugh Grant dans le rôle de Chopin ; La note bleue (1991); et Chopin : Désir d’amour (2002). [239]
La vie de Chopin a été couverte dans un documentaire BBC Omnibus de 1999 par András Schiff et Mischa Scorer , [240] dans un documentaire de 2010 réalisé par Angelo Bozzolini et Roberto Prosseda pour la télévision italienne, [241] et dans un documentaire BBC Four Chopin – The Women Behind The Musique (2010). [242]
Voir également
- Festival de piano Chopin Pristina
- Concours international de piano Chopin
- Le 1er Concours International Chopin sur Instruments d’époque
- Mémoires de Frédéric Chopin
Références
Remarques
- ^ UK : / ˈ ʃ ɒ p æ̃ , ˈ ʃ ɒ p æ n / , US : / ˈ ʃ oʊ p æ n , ʃ oʊ ˈ p æ n / , [1] français : [fʁedeʁik fʁɑ̃swa ʃɔpɛ̃] .
- ^ Polonais : [frɨˈdɛrɨk fraɲˈt͡ɕiʂɛk ˈʂɔpɛn] .
- ↑ Bien qu’aucun membre de la famille de Chopin n’ait épelé son nom de famille sous laforme polonisée Szopen , [ 2] cette dernière orthographe a été utilisée par de nombreux Polonais depuis son époque, y compris par ses contemporains poètes Juliusz Słowacki [3] et Cyprian Norwid . [4]
- ↑ D’après sa lettre du 16 janvier 1833 au président de la Société historique et littéraire polonaise de Paris, il est « né le 1er mars 1810 au village de Żelazowa Wola dans la province de Mazowsze ». [9]
- ↑ Le Conservatoire était affilié à l’ Université de Varsovie ; c’est pourquoi Chopin est compté parmi les anciens élèves de l’université
- ↑ A Szafarnia (en 1824 – peut-être son premier voyage en solitaire loin de chez lui – et en 1825), Duszniki (1826), Poméranie (1827) et Sanniki (1828). [23]
- ↑ Le palais Krasiński, aujourd’hui connu sous le nom de palais Czapski, est aujourd’hui l’ Académie des beaux-arts de Varsovie . En 1960, le salon de la famille Chopin ( salonik Chopinów ), une pièce autrefois occupée par la maison Chopin dans le palais, a été ouvert en tant que musée. [26]
- ↑ Un résident de 1837-1839 ici, l’artiste-poète Cyprian Norwid , écrira plus tard un poème, “Le piano de Chopin”, sur la défenestration de l’instrument par les troupes russes lors du soulèvement de janvier 1863 . [27]
- ^ Les originaux ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Seules les photographies survivent. [36]
- ↑ Un passeport français utilisé par Chopin est montré chez Emmanuel Langavant, [45]
- ^ Pour le réseau international de Schlesinger, voir Conway (2012), pp. 185–187, 238–239 [58]
- ^ Une photo du paquet de lettres survit, bien que les originaux semblent avoir été perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. Voir l’image sur la page Facebook de l’Institut Chopin , archivée sur ghostarchive.org (consultée le 28 mars 2021)
- ↑ Le piano Bauza entra finalement dans la collection de Wanda Landowska à Paris et fut saisi après la chute de Paris en 1940 et transporté par les envahisseurs à Leipzig en 1943. Il fut restitué en France en 1946, mais disparut par la suite. [83]
- ↑ Deux appartements voisins du monastère de Valldemossa, chacun abritant depuis longtemps un musée Chopin, ont été revendiqués comme étant la retraite de Chopin et Sand, et détenant le piano Pleyel de Chopin. En 2011, un tribunal espagnol de Majorque, en partie en excluant un piano qui avait été construit après la visite de Chopin là-bas – probablement après sa mort – a décidé quel était le bon appartement. [85]
- ↑ Le corps de Nourrit était escorté via Marseille jusqu’à ses funérailles à Paris, suite à son suicide à Naples. [89]
- ↑ Voir la photo dans l’article sur les mémoriaux de Frédéric Chopin , de la plaque sur l’ hôtel Baudard de Saint-James , commémorant la mort de Chopin.
- ↑ En 1879, le cœur est scellé dans un pilier de l’ église Sainte-Croix , derrière une tablette sculptée par Léonard Marconi . [128] Pendant l’invasion allemande de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale, le cœur a été retiré pour être gardé en lieu sûr et détenu dans les quartiers du commandant allemand, Erich von dem Bach-Zelewski . Il a ensuite été rendu aux autorités de l’église, mais il n’a pas encore été jugé sûr de le remettre dans son ancien lieu de repos. Il a été emmené dans la ville de Milanówek , où le cercueil a été ouvert et le cœur a été vu (sa grande taille a été notée). Il était entreposé dans l’église St. Hedwig. Le 17 octobre 1945, jour du 96e anniversaire de la mort de Chopin, il est remis à sa place dans l’église Sainte-Croix.[129]
- ↑ Le piano sur la photo, un Pleyel de la période 1830-1849, n’était pas celui de Chopin.
- ↑ En 2018, une copie du piano Buchholtz de Chopin a été présentée pour la première fois publiquement au Teatr Wielki, Varsovie – Opéra national polonais [195] et a été utilisée par l’Institut Chopin de Varsovie pour leur premier concours international Chopin sur instruments d’époque . [196]
Citations
- ^ Wells, John C. (2008). Dictionnaire de prononciation Longman (3e éd.). Longman. ISBN 978-1-4058-8118-0.
- ^ Marcheur 2018 , p. 289.
- ^ Tomaszewski, Mieczysław (2003-2018). “Juliusz Słowacki” . chopin.nifc.pl (en polonais). Institut Frédéric Chopin . Récupéré le 29 novembre 2021 .
- ^ Poème Fortepian Szopena
- ^ Rosen 1995 , p. 284.
- ^ Hedley & Brown 1980 , p. 292.
- ^ un bcd Zamoyski 2010 , pp . 4–5.
- ^ un b Cholmondeley 1998 .
- ^ Chopin 1962 , p. 116.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 3.
- ^ Marcheur 2018 , p. 32.
- ^ Samson 2001 , §1, par. 1.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 7.
- ^ Mysłakowski, Piotr; Sikorsky, Andrzej. “Émilie Chopin” . Narodowy Instytut Fryderyka Chopina . Récupéré le 27 juin 2021 .
- ^ un b Zamoyski 2010 , pp. 5–6.
- ^ Szulc 1998 , pp. 41-42.
- ^ un b Samson 2001 , §1, para. 3.
- ^ Samson 1996 , p. 8.
- ^ Walker 2018 , p. 50–52.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 11-12.
- ^ un bc Samson 2001 , §1, par. 5.
- ^ Walker 2018 , p. 83–84.
- ^ Szklener 2010 , p. 8.
- ^ Samson 2001 , §1, par. 2.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 19-20.
- ^ Mieleszko 1971 .
- ^ Jakubowski 1979 , pp. 514–515.
- ^ un bc Zamoyski 2010 , p. 43.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 47.
- ^ Marcheur 2018 , p. 109-110.
- ^ Kallberg 2006 , p. 66.
- ^ Walker 2018 , p. 153-155.
- ^ Niecks 1902 , p. 125.
- ^ Walker 2018 , p. 173-177.
- ^ Walker 2018 , p. 177–78.
- ^ Kuhnke 2010 .
- ^ Zamoyski 2010 , p. 45.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 35.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 37-39.
- ^ un b Jachimecki 1937 , p. 422.
- ^ Samson 2001 , §2, para. 1.
- ^ Samson 2001 , §2, para. 3. La revue se trouve maintenant à la Bibliothèque nationale de Pologne .
- ^ Marcheur 2018 , p. 202.
- ^ Samson 2001 , §1, par. 6.
- ^ “Passeport français de Chopin” . Site Chopin – musicien français . Récupéré le 28 mars 2021 .
- ^ un b Zamoyski 2010 , p. 128.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 106.
- ^ Marcheur 2018 , p. 19.
- ^ Eigeldinger 2001 , passim.
- ^ Walker 2018 , pp. 302 et suiv., 309, 365.
- ^ Samson 2001 , §3, par. 2.
- ^ Zamoyski 2010 , pp. 106=107.
- ^ Schumann 1988 , p. 15-17.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 88.
- ^ un bc Hedley 2005 , pp. 263–264.
- ^ Conway 2012 , p. 226 & note 9.
- ^ Samson 2001 , §2, para. 5.
- ^ Conway 2012 .
- ^ Niecks 1902 , p. 313.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 118-119.
- ^ Szulc 1998 , p. 137.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 119-120.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 126-127.
- ^ un b Jachimecki 1937 , p. 423.
- ^ Chopin 1962 , p. 144.
- ^ Hall-Swadley 2011 , p. 31.
- ^ un bc Hall- Swadley 2011 , p. 32.
- ^ un bc Schonberg 1987 , p. 151.
- ^ Hall-Swadley 2011 , p. 33.
- ^ un b Walker 1988 , p. 184.
- ^ Schonberg 1987 , pp. 151–152.
- ^ Samson 2001 , §3, par. 3.
- ^ Chopin 1962 , p. 141.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 137-138.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 147.
- ^ Chopin 1962 , pp. 151–161.
- ^ Załuski & Załuski 1992 , p. 226.
- ^ un bc Samson 2001 , §3, para. 4.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 154.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 159.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 161-162.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 162.
- ^ a b Appleyard, Brian (2018), “It Holds the Key”, The Sunday Times Culture Supplement, 3 juin 2018, pp. 8–9.
- ^ un b Zamoyski 2010 , p. 168.
- ^ Govan, Fiona (1er février 2011). “La dispute sur la résidence majorquine de Chopin résolue au piano” . Le Daily Telegraph . Archivé de l’original le 11 janvier 2022 . Récupéré le 31 août 2013 .
- ^ Samson 2001 , §3, par. 5.
- ^ “George Sand, Frédéric Chopin et l’orgue de ND du Mont” . 15 mars 2011 . Récupéré le 16 avril 2019 .
- ^ Chopin 1988 , p. 200, lettre à Fontana du 25 avril 1839.
- ^ Rogers 1939 , p. 25.
- ^ un b Samson 2001 , §4, para. 1.
- ^ Samson 2001 , §4, par. 4.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 197.
- ^ Atwood 1999 , p. 315.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 212.
- ^ Eddie 2013 , p. 8.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 227.
- ^ Sara Reardon, “Les hallucinations de Chopin peuvent avoir été causées par l’épilepsie” , The Washington Post , 31 janvier 2011, consulté le 10 janvier 2014.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 233.
- ^ Samson 2001 , §5, par. 2.
- ^ Samson 1996 , p. 194.
- ^ Walker 2018 , p. 552–554.
- ^ un bcd Jachimecki 1937 , p. 424.
- ^ Kallberg 2006 , p. 56.
- ^ Marcheur 2018 , p. 529.
- ^ Miller 2003 , §8.
- ^ un b Samson 2001 , §5, para. 3.
- ^ Szulc 1998 , p. 403.
- ^ Marcheur 2018 , p. 556.
- ^ Załuski & Załuski 1992 , pp. 227-229.
- ^ Walker 2018 , p. 579-581.
- ^ Załuski & Załuski 1993 .
- ^ Zamoyski 2010 , p. 279, Lettre du 30 octobre 1848.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 276-278.
- ^ Turnbull 1989 , p. 53.
- ^ Szulc 1998 , p. 383.
- ^ un b Samson 2001 , §5, para. 4.
- ^ Zamoyski 2010 , pp. 283-286.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 288.
- ^ Zamoyski 2010 , pp. 291–293.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 293.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 294.
- ^ Niecks 1902 , p. 1118.
- ^ Walker 2018 , p. 620-622.
- ↑ Atwood 1999 , pp. 412–413, traduction de « Funérailles de Frédéric Chopin », in Revue et gazette musicale , 4 novembre 1847.
- ^ Walker 2018 , p. 623-624.
- ^ Samson 1996 , p. 193.
- ^ Marcheur 2018 , p. 618.
- ^ “Église Sainte-Croix (Kościół Św. Krzyża)” . Dansvotrepoche.com . Récupéré le 7 décembre 2013 .
- ^ Ross 2014 .
- ^ Marcheur 2018 , p. 633.
- ^ Zamoyski 2010 , p. 286.
- ^ Majka, Gozdzik & Witt 2003 , p. 77.
- ^ Kuzemko 1994 , p. 771.
- ^ Kubba & Young 1998 .
- ^ Witt, Marchwica & Dobosz 2018 .
- ^ McKie 2017 .
- ^ Pruszewicz 2014 .
- ^ Hedley & Brown 1980 , p. 298.
- ^ Samson 2001 , §6 paragraphe 7.
- ^ Samson 2001 , §6 paragraphes 1–4.
- ^ Scholes 1938 , “Ballade”.
- ^ Ferguson 1980 , pp. 304–305.
- ^ un b Jones 1998b , p. 177.
- ^ Szulc 1998 , p. 115.
- ^ un b Jones 1998a , p. 162.
- ^ Hedley 2005 , p. 264.
- ^ Kennedy 1980 , p. 130.
- ^ Hedley & Brown 1980 , p. 294.
- ^ Kallberg 2001 , p. 4–8.
- ^ Stahlbrand .
- ^ “Frédéric François Chopin – 17 Chansons polonaises, Op. 74” . Archives classiques . Récupéré le 14 février 2010 .
- ^ Smialek, Guillaume; Trochimczyk, Maja (2015). Frédéric Chopin: Un guide de recherche et d’information (2e éd.). New York : Routledge . p. 144. ISBN 978-0-203-88157-6. OCLC 910847554 .
- ^ Atwood 1999 , pp. 166-167.
- ^ De Val & Ehrlich 1998 , p. 127.
- ^ De Val & Ehrlich 1998 , p. 129.
- ^ Règles du dix-huitième Concours international de piano Fryderyk Chopin (PDF) . Institut Frédéric Chopin .
- ^ Temperley 1980 , p. 306.
- ^ Ekier, janvier “Fondation pour l’édition nationale des œuvres de Fryderyk Chopin” . Institut Frédéric Chopin . Archivé de l’original le 9 août 2014 . Récupéré le 28 mars 2021 .
- ^ “Contexte historique” . Les premières éditions de Chopin en ligne . Récupéré le 28 mars 2021 .
- ^ “Les Musées” . Bibliothèque Polonaise de Paris . Récupéré le 7 mars 2021 .
- ^ Temperley 1980 , p. 298.
- ^ Temperley 1980 , p. 305.
- ^ un b Hutchings 1968 , p. 137.
- ^ Rosen 1995 , pp. 262-278.
- ^ Jones 1998a , pp. 161–162.
- ^ un b Temperley 1980 , p. 304.
- ^ Jones 1998b , pp. 177–179.
- ^ Reiss & Brown 1980 , p. 51.
- ^ Brown 1980 , p. 258.
- ^ un b Jones 1998a , p. 160.
- ^ Hedley 2005 , p. 263.
- ^ Jones 1998a , pp. 160-161.
- ^ Jones 1998a , p. 161.
- ^ Rosen 1995 , p. 83.
- ^ Hamilton 2008 , pp. 101–102.
- ^ un b Samson 2001 , §9 para. 2.
- ^ Leikin 1994 , pp. 191–192.
- ^ Leikin 1994 , p. 117.
- ^ Petit 1999 , p. 289.
- ^ Rosen 1995 , pp. 294-297.
- ^ Temperley 1980 , pp. 302–303.
- ^ Samson 1994 , p. 136.
- ↑ Cité dans Eigeldinger 1988 , p. 18
- ↑ Cité dans Eigeldinger 1988 , p. 23
- ^ Eigeldinger 1988 , p. 18-20.
- ^ Bellman 2000 , pp. 149–150.
- ↑ Cité dans Bellman 2000 , p. 150 ; l’élève était Emilie von Gretsch.
- ^ Bellman 2000 , pp. 153-154.
- ↑ Cité dans Eigeldinger 1988 , p. 272
- ↑ Cité dans Bellman 2000 , p. 154
- ^ Latham 2011 .
- ^ Rosen 1995 , p. 413.
- ^ Muller-Streicher 1949 , p. 138.
- ^ Majorek, Czeslaw; Zasztoft, Leszek (1991). “Popularyzacja nauki w Krolestwie Polskim w latach 1864–1905” . Histoire de l’éducation trimestrielle . 31 (1): 109. doi : 10.2307/368794 . ISSN 0018-2680 . JSTOR 368794 .
- ^ “Narodowy Instytut Fryderyka Chopina” . muzeum.nifc.pl . Récupéré le 24 juin 2021 .
- ^ Moran, Michael (31 janvier 2018). “1er Concours International Chopin sur Instruments d’époque. 2-14 septembre 2018” . Festivals et concours de musique classique en Pologne et en Allemagne – avec des détours occasionnels sans rapport . Récupéré le 24 juin 2021 .
- ^ un b Audéon 2016 .
- ^ Liszt, Franz; Cook, M. Walker (1er avril 1877). “La vie de Chopin” . The Musical Times and Singing Class Circular . 18 (410) : 184. doi : 10.2307/3351980 . ISSN 0958-8434 . JSTOR 3351980 .
- ^ Schumann 1988 , p. 114.
- ^ Cooke 1965-1966 , pp. 856-861. sfn error: no target: CITEREFCooke1965–1966 (help)
- ^ Liszt 1880 , 1503.
- ^ Cité de l’essai de 1923 de Szymanowski, “Fryderyk Chopin”; Downes 2001 , p. 63 et n. 58
- ^ Golos 1960 , pp. 439–442.
- ^ Milewski 1999 , pp. 113-121.
- ^ Taruskin 2010 , pp. 344-345.
- ^ Taruskin 2010 , p. 346.
- ^ Rosen 1995 , pp. 361–363.
- ^ Atwood 1999 , p. 57.
- ^ Conway 2012 , p. 229-230.
- ^ Walker 2018 , p. 422-423.
- ^ Walker 2018 , p. 464–467.
- ^ Bellman 2000 , pp. 150-151.
- ^ Wheeldon 2009 , p. 55–62.
- ^ Jones 1998b , p. 180.
- ^ Temperley 1980 , p. 307.
- ^ Bowers 1996 , p. 134.
- ^ Wojtkiewicz 2013 .
- ^ Hommage à Chopin : Partitions du projet de bibliothèque internationale de partitions musicales
- ^ Taruskin 1996 , pp. 546-547.
- ^ “Le Mystère de la Musique Manquante” . Barre latérale . Théâtre de ballet américain . Récupéré le 22 avril 2021 .
- ^ Zank 2005 , p. 266.
- ^ Knyt 2017 , p. 280.
- ^ Kallberg 1992 , pp. 104-106.
- ^ Kallberg 1992 , pp. 106-107.
- ^ Dit 1995 .
- ^ Rosen 1995 , pp. 284–285, 358–359, 452–453.
- ^ “About Competition” Archivé le 7 juillet 2013 sur Wayback Machine , site Web du Concours international Chopin, consulté le 12 janvier 2014.
- ^ “Institutions liées à Chopin – Associations” , site Web de l’Institut Fryderyk Chopin, consulté le 5 janvier 2014.
- ^ “Chopin sur YouTube” , site Web de l’Institut Fryderyk Chopin, consulté le 27 mars 2021.
- ^ “Chopin” , site Web de la British Library, consulté le 22 décembre 2013. Enregistrements accessibles gratuitement en ligne dans toute l’ Union européenne .
- ^ Methuen-Campbell 1981 , pp. 241–267.
- ^ Anthony Tommasini et al., “1 Composer, 2 Centuries, Many Picks” , The New York Times , 27 mai 2010, consulté le 28 décembre 2013.
- ↑ Site Internet du Grand Prix du Disque Frédéric Chopin , consulté le 2 janvier 2014.
- ^ Andrzej Hejmej, tr. Philip Stoeckle, « Chopin et sa musique dans la littérature » , site Web Chopin.pl (archivé), consulté le 28 mars 2021
- ^ Ashbrook 2001 .
- ^ Lance 2001 .
- ^ “Fryderyk Chopin – Centre d’information – Filmographie” . fr.chopin.nifc.pl . chopin.nifc.pl. 2003–2018 . Récupéré le 5 mars 2020 .
- ^ Soister 2002 , p. 62.
- ^ Iwona Sowińska, tr. Philip Stoeckle, “Chopin va au cinéma” Archivé le 23 octobre 2013 à la Wayback Machine , sur le site chopin.pl , consulté le 4 janvier 2014. Le site donne des détails sur de nombreux autres films mettant en vedette Chopin.
- ^ Michael Church (13 mai 1999). “Un exilé du monde moderne” . L’Indépendant . Récupéré le 3 mai 2018 .
- ^ Thompson 2016 , p. 600-601.
- ^ “Chopin – Les femmes derrière la musique” . BBC . Récupéré le 28 mars 2021 .
Bibliographie
- Ashbrook, William (2001) [1992]. “Chopin (opéra d’Orefice)” . Grove Music Online (8e éd.). Presse universitaire d’Oxford. (abonnement ou abonnement à une bibliothèque publique du Royaume -Uni requis)
- En ligneAtwood, William G. (1999). Les univers parisiens de Frédéric Chopin . New Haven et Londres : Yale University Press . ISBN 978-0-300-07773-5.
- Audéon, Hervé (2016). “L’œuvre de Frédéric Kalkbrenner (1785–1849) et ses rapports avec Frédéric Chopin (1810–1849)”. Dans Hug, Vanya (éd.). Chopin et son temps / Chopin et son temps (en français). ISBN 978-3-0343-2000-9.
- Bellman, Jonathan (automne 2000). “Chopin et ses imitateurs: émulations notées du” véritable style “de performance”. Musique du XIXe siècle . 24 (2): 149–160. doi : 10.2307/746839 . JSTOR 746839 .
- Bowers, Faubion (1996). Scriabine : une biographie . Mineola : Publications de Douvres . ISBN 978-0-486-28897-0.
- Brun, Maurice (1980). “Nocturne”. Dans Stanley Sadie (éd.). Le dictionnaire New Grove de la musique et des musiciens . Vol. 13. Londres : Macmillan Publishers . p. 258–259. ISBN 978-0-333-23111-1.
- Cholmondeley, Rose (1998). “Le mystère de l’anniversaire de Chopin” . La Société Chopin Royaume-Uni . Récupéré le 28 mars 2021 .
- Chopin, Frédéric (1988). Voynich, EL (éd.). Lettres de Chopin . New York : Publications de Douvres . ISBN 978-0-486-25564-4.
- Chopin, Fryderyk (1962). Correspondance choisie de Fryderyk Chopin . Traduit par Hedley, Arthur. Compilé par Bronisław Edward Sydow. Londres : Heinemann .
- Conway, David (2012). La juiverie dans la musique : entrée dans la profession des Lumières à Richard Wagner . Cambridge : Presse universitaire de Cambridge . ISBN 978-1-107-01538-8.
- Cooke, Charles (hiver 1965 – hiver 1966). “Chopin et Liszt avec une torsion fantomatique”. Remarques . 22 (2): 855–861. doi : 10.2307/894930 . JSTOR 894930 .
- De Val, Dorothy; En ligneEhrlich, Cyril (1998). “Répertoire et Canon”. Dans Rowland, David (éd.). Le compagnon de Cambridge au piano . Cambridge : Presse universitaire de Cambridge . p. 115–134. ISBN 978-0-521-47986-8.
- Downes, Stephen (2001). “Eros et paneuropéisme”. En blanc, Harry ; Murphy, Michael (éd.). Constructions musicales du nationalisme: essais sur l’histoire et l’idéologie de la culture musicale européenne 1800–1945 . Cork : Presse universitaire de Cork . p. 51–71. ISBN 978-1-85918-322-9.
- Eddie, Guillaume (2013). Charles Valentin Alkan : sa vie et sa musique . Farnham: Ashgate Publishing, Ltd.ISBN 978-1-4094-9364-8.
- Eigeldinger, Jean-Jacques (1988). Chopin : pianiste et pédagogue vu par ses élèves . Traduit par Naomi Shochet. Cambridge : Presse universitaire de Cambridge . ISBN 978-0-521-36709-7.
- Eigeldinger, Jean-Jacques (août 2001). “Chopin et Pleyel” (PDF) . Musique ancienne . 29 (3): 389–396. doi : 10.1093/em/29.3.389 . JSTOR 3519183 .
- Ferguson, Howard (1980). “Étude”. Dans Stanley Sadie (éd.). Le dictionnaire New Grove de la musique et des musiciens . Vol. 18. Londres : Macmillan Publishers . p. 304–305.
- Golos, George S. (octobre 1960). “Certains prédécesseurs slaves de Chopin”. Le Trimestriel Musical . 46 (4): 437–447. doi : 10.1093/mq/XLVI.4.437 . JSTOR 740748 .
- Hall-Swadley, Janita R., éd. (2011). Les Écrits Recueillis de Franz Liszt : F. Chopin . Lanham : Presse d’épouvantail . ISBN 978-1-4616-6409-3.
- Hamilton, Kenneth (2008). Après l’Age d’Or : Pianisme Romantique et Interprétation Moderne . Oxford : presse universitaire d’Oxford . ISBN 978-0-19-517826-5.
- Hedley, Arthur (2005). “Chopin, Frédéric (François)”. Encyclopædia Britannica . Vol. 3 (15e éd.). Chicago : Encyclopædia Britannica, Inc. p. 263–264.
- Hedley, Arthur ; Brun, Maurice (1980). “Chopin, Fryderyk Franciszek [Frédéric François]”. Dans Stanley Sadie (éd.). Le dictionnaire New Grove de la musique et des musiciens . Vol. 4. Londres : Macmillan Publishers . pages 292 à 298, articles 1 à 6. ISBN 978-0-333-23111-1.
- Hutchings, AGB (1968). “L’ère romantique”. À Robertson, Alec; Stevens, Denis (dir.). L’histoire de la musique Pelican 3: classique et romantique . Harmondsworth: Livres sur les pingouins . p. 99–139. ISBN 978-0-14-020494-0.
- Jachimecki, Zdzisław (1937). “Chopin, Frédérick Franciszek”. Polski słownik biograficzny (en polonais). Vol. 3. Cracovie : Polska Akademia Umiejętności . p. 420–426.
- Jakubowski, Jan Zygmunt, éd. (1979). Literatura polska od średniowiecza to pozytywizmu [ Littérature polonaise du Moyen Âge au positivisme ] (en polonais). Varsovie : Państwowe Wydawnictwo Naukowe . ISBN 978-83-01-00201-5.
- Jones, J. Barrie (1998a). “Musique pour piano pour salle de concert et salon vers 1830–1900”. Dans Rowland, David (éd.). Le compagnon de Cambridge au piano . Cambridge : Presse universitaire de Cambridge . p. 151–175. ISBN 978-0-521-47986-8.
- Jones, J. Barrie (1998b). “Nationalisme”. Dans Rowland, David (éd.). Le compagnon de Cambridge au piano . Cambridge : Cambridge University Press. pp. 176–191. ISBN 978-0-521-47986-8.
- Kallberg, Jeffrey (été 2001). “La marche de Chopin, la mort de Chopin”. Musique du XIXe siècle . 25 (1): 3–26. doi : 10.1525/ncm.2001.25.1.3 . JSTOR 10.1525/ncm.2001.25.1.3 .
- Kallberg, Jeffrey (2006) [1994]. “Les petites voix de fées : sexe, histoire et sens chez Chopin” . Dans la patinoire, John; Samson, Jim (éd.). Études de Chopin 2 . Cambridge : Presse universitaire de Cambridge . ISBN 978-0-521-03433-3.(version e-book de la publication de 1994)
- Kallberg, Jeffrey (été 1992). “L’Harmonie de la Table à Thé: Genre et Idéologie dans le Piano Nocturne”. Représentations . 39 (39): 102–133. doi : 10.2307/2928597 . JSTOR 2928597 .
- Kennedy, Michael (1980). Le dictionnaire concis d’Oxford de la musique . Oxford : presse universitaire d’Oxford . ISBN 978-0-19-311315-2.
- En ligneKnyt, Erinn E. (2017). “Ferruccio Busoni et la ‘moitié’ de Frédéric Chopin”. Le Journal de Musicologie . 34 (2): 241-280. doi : 10.1525/jm.2017.34.02.241 . JSTOR 26414211 .
- Kubba, Adam; Jeune, Madeleine (1998). “La longue souffrance de Frédéric Chopin” (PDF) . Poitrine . 113 (1): 210-216. doi : 10.1378/chest.113.1.210 . PMID 9440592 . Archivé de l’original (PDF) le 19 août 2014 . Récupéré le 28 mars 2021 .
- Kuhnke, Monica (2010). “Oryginalne kopie, czyli historia portretów rodziny Chopinów” [Copies originales, ou l’histoire des portraits de la famille Chopin] (PDF) . Cenne Bezcenne Utracone (en polonais). 62 (1) : 8–12 . Récupéré le 28 mars 2021 .( résumé en anglais )
- Kuzemko, JA (1994). “Les maladies de Chopin” . Journal de la Société royale de médecine . 87 (12): 769–772. PMC 1294992 . PMID 7853308 .
- Lanza, Andrea (2001). “Orefice, Giacomo” . Grove Music Online (8e éd.). Presse universitaire d’Oxford. (abonnement ou abonnement à une bibliothèque publique du Royaume -Uni requis)
- Latham, Alison (2011). “Rubato” . Compagnon d’Oxford à la musique en ligne . Oxford : presse universitaire d’Oxford . ISBN 978-0-19-957903-7. Récupéré le 27 mars 2021 .
- Leikin, Anatole (8 décembre 1994). “Les Sonates”. Dans Samson, Jim (éd.). Le compagnon de Cambridge de Chopin . Compagnons de Cambridge pour la musique . Cambridge : Presse universitaire de Cambridge . ISBN 978-1-139-82499-6.
- Liszt, Franz (1880). Vie de Chopin . Traduit par Cook, Martha Walker (4e éd.). Projet Gutenberg . Récupéré le 28 mars 2021 .
- Majka, Lucyna; Gozdzik, Joanna; Witt, Michal (2003). “La fibrose kystique – une cause probable de la souffrance et de la mort de Frédéric Chopin” (PDF) . Journal de génétique appliquée . 44 (1): 77–84. PMID 12590184 .
- McKie, Robin (4 novembre 2017). “L’examen du cœur mariné de Chopin résout l’énigme de sa mort prématurée” . Le Gardien . Récupéré le 5 novembre 2017 .
- Methuen-Campbell, James (1981). Chopin jouant du compositeur à nos jours . Londres : Victor Gollancz . ISBN 978-0-575-02884-5.
- Mieleszko, Jadwiga (1971). Pałac Czapskich [ Palais Czapski ] (en polonais). Varsovie : Państwowe Wydawnictwo Naukowe .
- Milewski, Barbara (automne 1999). “Les Mazurkas de Chopin et le Mythe du Folk”. Musique du XIXe siècle . 23 (2): 113–135. doi : 10.2307/746919 . JSTOR 746919 .
- Miller, Lucasta (21 juin 2003). “Le compositeur qui n’a jamais grandi” . Le Gardien . Récupéré le 18 décembre 2020 .
- Müller-Streicher, Friedericke (1949). “Aus dem Tagebuch einer Wiener Chopin-Schülerin (1839–1841, 1844–1845)” [Extrait du journal d’un étudiant viennois de Chopin (1839–1841, 1844–1845)]. Chopin-Almanach zur hundertsten Wiederkehr des Todesjahres von Fryderyk Chopin [ Almanach de Chopin pour le centième anniversaire de la mort de Fryderyk Chopin ] (en allemand). Potsdam : Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion . p. 134–142. OCLC 460555146 .
- Niecks, Frédéric (1902). Frederick Chopin comme homme et musicien (3e éd.). Londres : Novello & Co. OCLC 22702671 . Récupéré le 27 mars 2021 – via Project Gutenberg .
- Petty, Wayne C. (printemps 1999). « Chopin et le fantôme de Beethoven ». Musique du XIXe siècle . 22 (3): 281–299. doi : 10.2307/746802 . JSTOR 746802 .
- Pruszewicz, Marek (22 décembre 2014). “Le mystère de la mort de Chopin” . BBC . Récupéré le 31 janvier 2019 .
- Reiss, Jozef ; Brun, Maurice (1980). “Polonaise”. Dans Sadie, Stanley (éd.). Le dictionnaire New Grove de la musique et des musiciens . Vol. 15. Londres : Macmillan Publishers . p. 49=52. ISBN 978-0-333-23111-1.
- Rogers, Francis (1939). “Adolphe Nourrit”. Le Trimestriel Musical . 25 (1): 11–25. doi : 10.1093/mq/XXV.1.11 . JSTOR 738696 .
- Rosen, Charles (1995). La génération romantique . Cambridge, MA : Harvard University Press . ISBN 978-0-674-77933-4.
- Ross, Alex (5 février 2014). « Le cœur de Chopin » . Le New-Yorkais . Récupéré le 24 mars 2021 .
- Said, Edward (12 décembre 1995). “Le génie de Bach, l’excentricité de Schumann, l’impitoyabilité de Chopin, le cadeau de Rosen” . Revue de livres de Londres . 17 (18) . Récupéré le 24 mars 2021 .
- Samson, Jim (1994). Le compagnon de Cambridge de Chopin . Cambridge : Presse universitaire de Cambridge . ISBN 978-0-521-47752-9.
- Samson, Jim (1996). Chopin . Oxford : presse universitaire d’Oxford . ISBN 978-0-198-16495-1.
- Samson, Jim (2001). “Chopin, Frédérick Franciszek” . Grove Musique en ligne . Oxford, Angleterre : Oxford University Press . doi : 10.1093/gmo/9781561592630.article.51099 . ISBN 978-1-56159-263-0. (abonnement ou abonnement à une bibliothèque publique du Royaume -Uni requis)
- Scholes, Percy (1938). Le compagnon d’Oxford à la musique . Londres : Oxford University Press . OCLC 1079764443 .
- En ligneSchonberg, Harold C. (1987). Grands Pianistes . New York : Simon et Schuster . p. 151 . ISBN 978-0-671-63837-5.
- Schumann, Robert (1988). Plaisants, Henry (éd.). Schumann sur la musique : une sélection des écrits . New York : Douvres. ISBN 978-0-486-25748-8.
- Soister, John T. (2002). Conrad Veidt à l’écran: une filmographie illustrée complète . Jefferson, Caroline du Nord et Londres : McFarland & Company . ISBN 978-0-7864-4511-0.
- Stahlbrand, Robert. « Œuvres de Chopin – Liste complète » . Société de piano . Récupéré le 28 mars 2021 .
- En ligneSzklener, Artur (2010). « Fryckowe lato : czyli wakacyjne muzykowanie Chopina » [Les étés de Fritz : les vacances musicales de Chopin]. Magazyn Chopin : Miesięcznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (en polonais) (4) : 8–9.
- Szulc, Tad (1998). Chopin à Paris : la vie et l’époque du compositeur romantique . New York : Scribner . ISBN 978-0-684-82458-1.
- Taruskin, Richard (1996). Stravinsky et les traditions russes . Oxford : presse universitaire d’Oxford . ISBN 978-0-19-816250-6.
- Taruskin, Richard (2010). Musique au XIXe siècle . Oxford : presse universitaire d’Oxford . ISBN 978-0-19-538483-3.
- Temperley, Nicholas (1980). “Chopin, Fryderyk Franciszek [Frédéric François]”. Dans Sadie, Stanley (éd.). Le dictionnaire New Grove de la musique et des musiciens . Vol. 4. Londres : Macmillan Publishers . p. 298–307. ISBN 978-0-333-23111-1.
- Thompson, Brian Christopher (2016). “Fryderyk Chopin par Angelo Bozzolini et Roberto Prosseda (critique)” . Remarques . 72 (3): 600–601. doi : 10.1353/not.2016.0042 . S2CID 193316471 .
- Turnbull, Michael TRB (1989). Monuments et statues d’Édimbourg . Édimbourg : Chambres . ISBN 978-0-550-20050-1.
- Walker, Alan (1988). Franz Liszt : Les années virtuoses 1811-1847 . Londres : Faber et Faber . ISBN 978-0-571-15278-0.
- Walker, Alan (2018). Frédéric Chopin : Une vie et une époque . Londres : Faber et Faber . ISBN 978-0-571-34855-8.
- Wheeldon, Marianne (2009). Le style tardif de Debussy . Bloomington : Presse universitaire de l’Indiana . ISBN 978-0-253-35239-2.
- Witt, Michal ; Marchwica, Wojciech; Dobosz, Tadeusz (2018). « Maladie non génétique mais infectieuse : tuberculomes multiples et péricardite fibrineuse comme symptômes pathognomoniques de la tuberculose de Frédéric Chopin » (PDF) . Journal de génétique appliquée . 59 (4): 471–473. faire : 10.1007/s13353-018-0456-3 . PMID 30047032 . S2CID 51718815 .
- Wojtkiewicz, Mariola (2013).”L’impact de la musique de Chopin sur le travail des compositeurs des XIXe et XXe siècles” . Chopin.pl (en archive) . Traduit par Ossowski, Jerzy. Archivé de l’original le 23 octobre 2013 . Récupéré le 28 mars 2021 .
- Załuski, Iwo; Załuski, Pamela (mai 1992). “Chopin à Londres”. Les Temps Musicaux . 133 (1791): 226–230. doi : 10.2307/1193699 . JSTOR 1193699 .
- Załuski, Iwo; Załuski, Pamela (1993).”L’automne écossais de Chopin” . Revue contemporaine (1er juillet 1993) . Récupéré le 28 mars 2021 .
- Zamoyski, Adam (2010). Chopin : Prince des Romantiques . Londres : HarperCollins . ISBN 978-0-00-735182-4.
- Zank, Stephen (2005).Maurice Ravel : Guide de la recherche . New York : Routledge . ISBN 978-0-8153-1618-3.
Lectures complémentaires
- Azoury, Pierre (1999).Chopin à travers ses contemporains . Westport, Connecticut : Greenwood Press . ISBN 978-0-313-30971-7.
- Jeune, Pablo ; et coll. (2014). “Federico Chopin (1810–1849) et son enfermedad” (PDF) . Revista médica de Chile (en espagnol). 142 (4): 529–535. doi : 10.4067/S0034-98872014000400018 . PMID 25117047 . Récupéré le 28 mars 2021 .Résumé en anglais.
Liens externes
Frédéric Chopindans les projets frères de Wikipédia
-
![]()
![]() Médias de Commons
Médias de Commons -
![]()
![]() Citations de Wikiquote
Citations de Wikiquote
| Wikisource polonaise a un texte original lié à cet article : Frédéric Chopin |
- Documentaire de la BBC 2010, Chopin : les femmes derrière la musique , disponible sur YouTube , 90 minutes.
- “A la découverte de Chopin” . Radio BBC 3 .
- Works by or about Frédéric Chopin at Internet Archive
- Biography Archived 25 January 2012 at the Wayback Machine on official site of the Fryderyk Chopin Institute
- Chopin’s last piano (Pleyel 14810)
- Chopin iconography – website in Polish with detailed comment on genuine (and not-so-genuine) representations of the composer.
- Chopin’s pianos
- 1st International Chopin Competition on Period Instruments
- Chopin’s correspondence
Music scores
- Partitions gratuites de Frédéric Chopin à l’ International Music Score Library Project (IMSLP)
- Chopin Early Editions , une collection de plus de 400 premières et premières éditions imprimées de compositions musicales de Frédéric Chopin publiées avant 1881
- Chopin’s First Editions Online propose une interface qui permet d’ouvrir simultanément trois partitions navigables dans des cadres pour faciliter la comparaison.
Portails : ![]()
![]() Musique classique
Musique classique ![]()
![]() Biographie
Biographie ![]()
![]() Pologne
Pologne ![]()
![]() Musique
Musique